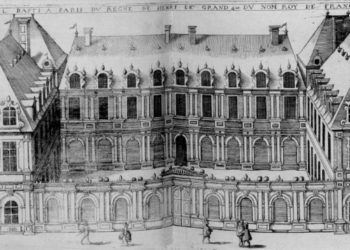Propos recueillis par Benoît Drouot, agrégé d’histoire-géographie
Entretien paru dans le n° 686 du DDV (printemps 2022)
Les idéologies et politiques raciales sont habituellement associées aux XIXe et XXe siècles, au colonialisme européen, au nazisme, aux États-Unis ou à l’apartheid. Pourtant vous écrivez dans Race et histoire dans les sociétés occidentales (XVe-XVIIIe siècle) qu’elles tinrent une « place éminente » (p. 8) dans les sociétés d’Ancien Régime. Quelle est l’ambition de votre livre ?
Jean-Frédéric Schaub : Notre livre amplifie en effet l’étude historique des processus de racialisation par la restitution de leurs manifestations au Moyen Âge et à l’époque moderne. Cette proposition entraîne deux conséquences. D’abord, nous venons en renfort des travaux qui ont placé la question raciale au cœur d’enquêtes scientifiques et universitaires portant sur le monde contemporain. Il s’ensuit que nous contribuons à installer ces questions à l’agenda de la formation en histoire et, du même coup, nous invitons à les délivrer des polémiques qui les prennent aujourd’hui en otage dans le débat public. C’est pourquoi notre livre s’adosse à un appareil de références érudites, refusant par là même que notre réflexion adopte le style d’un essai reflétant les humeurs du moment.
Nous avons également placé l’accent sur l’association et le croisement des traditions universitaires, puisant dans les travaux publiés en cinq langues (français, anglais, espagnol, portugais, italien) et même un peu plus. Nous critiquons le nombrilisme français et la réduction du monde à l’existence d’une bibliothèque universelle anglophone. Enfin, nous n’avons rejeté aucun type de traces conservées du passé de nos sociétés : archives des procédures, doctrines savantes, œuvres de littérature, témoignages personnels, iconographies et mêmes objets. Nous avons borné l’examen aux sociétés occidentales, par manque de connaissance de première main sur les autres régions où race et histoire se croisent. De ce point de vue, notre enquête est située.
Le XVe siècle ibérique, à partir des pogroms de Séville en 1391, vous apparaît comme un moment fondateur de la formation des catégories raciales en Occident. Qu’est-ce qui se joue à ce moment-là ?
Jean-Frédéric Schaub : Pour comprendre ces épisodes, il faut partir d’une idée contre-intuitive : en Espagne, les juifs ne forment pas une société allogène mais autochtone. En effet, les juifs y ont été les premières cibles et les premiers relais de la prédication chrétienne, bien avant que les invasions wisigothiques aient donné forme au royaume chrétien d’Espagne à la fin de l’Empire romain. S’ensuivirent la conquête islamique et la contre-conquête chrétienne, du VIIIe au XVe siècle. Sous autorité chrétienne ou islamique, les communautés juives ont su se perpétuer, tout en absorbant des traits empruntés aux autres religions du Livre.
« Dès la fin du XIVe siècle, en Espagne, les statuts de pureté de sang qui excluaient les descendants de juifs convertis sont une première régulation fondée sur l’identification d’un sang jugé infâme. C’est d’autant plus frappant que ces juifs étaient alors enracinés dans les sociétés d’Espagne depuis plus de quinze siècles ! »
Jean-Frédéric Schaub
À la fin du XIVe siècle, au cours d’une poussée de fièvre millénariste, des prédicateurs franciscains lançant la population contre les juifs de Séville crurent qu’ils obtiendraient la conversion de toutes leurs communautés. Les convertis furent bien accueillis dans la société chrétienne. Mais l’entente ne dura pas, lorsque les « vieux chrétiens » virent que les « nouveaux chrétiens » les concurrençaient pour l’attribution des meilleures places et des bons mariages. On décréta que les chrétiens d’origine juive n’étaient pas des paroissiens comme les autres. Leur conversion était considérée douteuse et la présomption de leur infidélité était signalée par leur généalogie : coulait dans leurs veines le sang d’ancêtres qui continuait de les infecter. Les statuts de pureté de sang qui excluaient les descendants de convertis sont une première régulation fondée sur l’identification d’un sang jugé infâme. C’est d’autant plus frappant que ces juifs étaient alors enracinés dans les sociétés d’Espagne depuis plus de quinze siècles !
Dans le processus de formation des catégories raciales, comment s’articulent l’antisémitisme chrétien qui sévit au XVe siècle en péninsule ibérique et la déportation de millions d’Africains réduits en esclavage vers l’Amérique ?
Jean-Frédéric Schaub : L’Espagne et le Portugal partagent avec d’autres pays européens une conception héréditaire de la noblesse qui ménage toutefois la possibilité de l’anoblissement de roturiers. Mais, à la différence des leurs voisins, les Ibériques définissent la condition privilégiée par opposition, non seulement au statut héréditaire de roturier, mais aussi à une généalogie entachée par des ancêtres juifs ou musulmans. Telle est la conception des différences sociales et naturelles qu’avaient en tête les conquérants de ce qu’on appelait autrefois les « grandes découvertes ». Ils ont ainsi projeté sur la société coloniale des distinctions fondées sur la pureté de sang.
L’écrasante majorité des métis nés de père espagnol et mère amérindienne ont été tenus pour impurs, d’abord parce que leur père n’ayant pas épousé leur mère ils étaient tenus pour bâtards, ensuite parce que s’imposa l’idée que les Amérindiens étaient par nature inférieurs. La stigmatisation des métis opéra selon un mécanisme qui rappelle le rejet des convertis. Ces processus se retrouvent dans la déshumanisation des Africains déportés aux Amériques. Avec la croissance de la traite atlantique s’établit une équivalence entre nature noire et statut servile, en dépit de l’existence de libres Africains, affranchis ou descendants d’affranchis. Arrachés à leur milieu d’origine et broyés par la brutalité de la traite, ces esclaves offraient le spectacle d’une humanité désorientée et dégradée. Il n’en fallait guère plus pour affirmer que ces hommes n’en étaient pas vraiment et que leur sort était acceptable. Leur condition et leur nature, signalées par la couleur de leur peau, étaient alors tenues pour héréditaire.
Vous revenez à de nombreuses reprises sur l’idée selon laquelle les processus de racialisation et le racisme consistent avant tout à « produire une recharge d’altérité » (p. 172) et à figer un ordre social quand les distances se réduisent. Que révèlent, à ce sujet, l’histoire de la noblesse européenne et celle du métissage dans l’Amérique coloniale ? Quelle place y tiennent le sang et la quête de pureté ?
Jean-Frédéric Schaub : Nous entendons montrer que la catégorisation raciale ne se fonde pas en premier lieu sur des différences visibles au premier coup d’œil. Au Moyen Âge comme au XXe siècle, dans le cas de l’Europe occupée par le IIIe Reich, il fut nécessaire d’imposer une marque vestimentaire, la rouelle et l’étoile jaune, pour distinguer dans l’espace public la minorité réprouvée et persécutée. C’est dire si la différence était tenue pour imperceptible. À l’autre extrémité de l’expérience de racialisation, on voit comment la peau noire des Africains et des descendants d’Africains est investie comme le marqueur d’une infériorité naturelle et d’un statut, lui aussi, inférieur.
« C’est la naturalisation de l’être humain, la possibilité même de l’étudier en tant qu’entité naturelle, comme une espèce parmi d’autres, qui contribue à la division de l’humanité en différentes races. »
Silvia Sebastiani
Entre ces deux pôles, on peut documenter des situations intermédiaires. C’est le cas de sociétés coloniales qui ont engendré des métis, où la caractérisation des personnes et des groupes repose sur des faisceaux de signes où le phénotype peut jouer un rôle, mais sans suffire par lui-même. Nous en tirons la conclusion que la différence n’est jamais une donnée immédiate de l’expérience sociale mais toujours le produit d’une élaboration politique et culturelle. Mais ce qui revient dans tous les cas, c’est l’usage des notions de « lignée » ou de « sang », qui permettent de traduire les distinctions sociales dans le vocabulaire de la reproduction naturelle.
Les Lumières introduisent, selon vous, un « tournant anthropologique ». Alors que l’homme est « à la fois naturalisé et historicisé » (p. 320) sont débattues les frontières qui le séparent de l’animal. Comment cette rupture contribue-t-elle au processus de racialisation ?
Silvia Sebastiani : L’une des formes les plus communes de racialisation est l’animalisation de l’esclave. Ce procédé est loin d’être inédit, et on en trouve des exemples dès l’Antiquité. La nouveauté du XVIIIe siècle réside précisément dans le double geste que vous soulignez : la naturalisation et l’historicisation de l’être humain. Carl von Linné et Georges-Louis Buffon, selon des modalités antagonistes, insèrent « l’homme » au sein du règne animal dans deux monuments de l’histoire naturelle des Lumières1Carl von Linné, Systema naturæ per Regna Tria Naturae, Secundum Classes, Ordines, Genera, Species (1e éd. 1735), Stockholm, L. Salvii, 1766 (c’est à partir de la 10e édition en 1758 que Linné révolutionne la nomenclature classique, introduisant les termes de « homo sapiens », « primates » et « mammifères ») ; Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon, Histoire naturelle générale et particulière avec la description du Cabinet du Roi, 36 vol., Paris, Imprimerie Royale, 1749-1789 (disponible intégralement en ligne sur le site web créé et édité par Pietro Corsi et Thierry Hoquet : buffon.cnrs.fr)., hors du cadre biblique. C’est la naturalisation de l’être humain, la possibilité même de l’étudier en tant qu’entité naturelle, comme une espèce parmi d’autres, qui contribue à la division de l’humanité en différentes races. L’homme est alors inscrit dans le même régime de savoirs que le reste de la nature. Avec son entrée dans le règne animal, devient centrale la question des frontières : entre l’humain et l’animal, entre l’homme et l’homme, entre les sexes. L’abolition de la frontière avec l’animal contribue à la racialisation de l’humanité, car elle conduit à la création de différentes gradations en son sein.
La remise en cause du statut privilégié de l’homme au sein de la nature s’accompagne de l’historicisation et de la temporalisation des sociétés humaines et de la nature elle-même. De Voltaire à Adam Smith, les historiens des Lumières dessinent une trajectoire universelle depuis l’état sauvage vers la société civile, au cours de laquelle les peuples passent d’une condition presque animale à la pleine humanité : le mot qui décrit ce processus est « civilisation », un néologisme qui se diffuse à partir des années 1750 en français et en anglais. L’humanité devient alors un produit historique et est ainsi située à la fois dans et au-dessus de la nature. En progressant, l’homme se fait le maître de la nature : le « civilisé » domine le « sauvage », resté au seuil de l’Histoire. On recourt alors à la race pour expliquer les progrès inégaux des peuples.

En embrassant les Lumières à l’échelle européenne, vous montrez que la diversité des points de vue interdit de les enfermer dans un discours univoque et consensuel. Comment penser la tension entre la place des Lumières dans la construction de la modernité et de l’universalisme d’une part, et leur centralité dans la construction de la race d’autre part ?
Silvia Sebastiani : Cette question a fait couler beaucoup d’encre sans créer de consensus entre les historiens. Dans notre livre, nous essayons de rendre compte des désaccords. En effet, la question est complexe : il s’agit de comprendre comment l’universalisme, au sein duquel s’est déployé un discours sur les droits de l’homme et leur égalité, a également induit de nouvelles hiérarchies entre les groupes humains.
« Dans la longue histoire de la race dans les sociétés occidentales, la croyance dans le caractère naturel et héréditaire des qualités personnelles a servi aussi bien à distinguer les meilleurs qu’à stigmatiser les réprouvés, les deux opérations formant un tout. »
Silvia Sebastiani
La réponse peut sembler contre-intuitive : c’est lorsque s’affirme un droit universaliste et égalitaire des êtres humains qu’il devient d’autant plus nécessaire d’inventer des catégories qui justifient l’inégalité et décrètent les différences – comme la race. Quand la hiérarchie et l’inégalité forment un cadre incontesté, comme dans le système de l’esclavage par exemple, les justifications théoriques de l’inégalité sont inutiles : l’inégalité est un fait, décrété par la loi. C’est pourquoi le racisme devient un problème plus fort que jamais, au moment même de l’abolition de l’esclavage.
Mais plus qu’à résoudre l’interrogation sur l’humain, les philosophes des Lumières ont, selon nous, contribué à mettre l’homme en question. Leurs débats ont légué aux sciences humaines et sociales modernes un doute épistémologique sur la définition de l’humanité et ses frontières.
En quoi cette histoire de la race comme « ressource politique en Occident du XVe au XVIIIe siècle » (p. 481) peut-elle nous aider à saisir ce qui se joue au présent ?
Silvia Sebastiani : On peut répondre à cette question de plusieurs façons. Tout d’abord, il nous semble important d’expliquer comment une catégorie imaginaire a pu et peut encore marquer notre histoire. Ce livre cherche à montrer la complexité, la porosité et la multiplicité des formes que peut prendre la question raciale. C’est précisément cette malléabilité qui fait sa force. Dans la longue histoire de la race dans les sociétés occidentales, la croyance dans le caractère naturel et héréditaire des qualités personnelles a servi aussi bien à distinguer les meilleurs qu’à stigmatiser les réprouvés, les deux opérations formant un tout. Cela implique qu’il n’y a pas besoin de traits évidents pour distinguer les groupes humains : la différence peut toujours être créée, inventée, naturalisée… C’est pourquoi nous avons choisi de parler d’« altération », comme d’un processus de construction de la différence, plutôt que d’une « altérité » établie et immuable – un aspect qui s’applique bien aux sociétés actuelles.
Un autre point que nous souhaitons mettre en évidence est celui de la ténacité des stéréotypes et associations dans le cadre d’un temps long qu’il est crucial de prendre en compte. Pour se limiter à un seul exemple, l’association faite à la légère entre les figures politiques afro-descendantes et les orangs-outans/guenons/singes (nous l’avons trop souvent vue ces dernières années, avec Barack ou Michelle Obama aux États-Unis, Cécile Kyenge en Italie ou Christiane Taubira en France) n’a rien d’innocent : elle trouve ses racines dans les profondeurs de construction raciale et de son association au système de la traite. C’est du racisme à part entière. Nous voudrions donc que ce livre contribue à la réflexion sur la complexité des discours raciaux, qui ont traversé l’Europe et ses colonies, dès l’âge moderne et jusqu’à nos jours.
GÉNÉALOGIES, RACES ET POLITIQUE
Jean-Frédéric Schaub et Silvia Sebastiani montrent dans Race et histoire dans les sociétés occidentales (XVe-XVIIIe siècle) que la mobilisation de la race comme ressource politique en Occident précéda la colonisation en Amérique et les théorisations racistes du XIXe siècle. Sa signification primordiale est ambivalente : infamante quand elle vise au XVe siècle à maintenir les privilèges des vieux chrétiens ibériques par l’exclusion des juifs convertis, elle est signe d’élection quand les noblesses européennes adossent leur position sociale à la généalogie. Mais sa fonction politique est identique : maintenir des différences qui s’estompent. Le mécanisme se retrouve dans les exclusions imposées par les Anglo-Normands aux Irlandais à la fin du XIVe siècle et par les Européens aux métis en Amérique, ou dans le régime fondé sur la race généré par l’esclavage des Africains. Les Lumières apparaissent sous un jour complexe qui confronte la justification raciste de l’esclavage à l’élaboration d’une pensée universelle émancipatrice.
Race et histoire dans les sociétés occidentales (XVe-XVIIIe siècle), Jean-Frédéric Schaub et Silvia Sebastiani, Albin Michel, Paris, 2021, 512 p., 24,90 €.
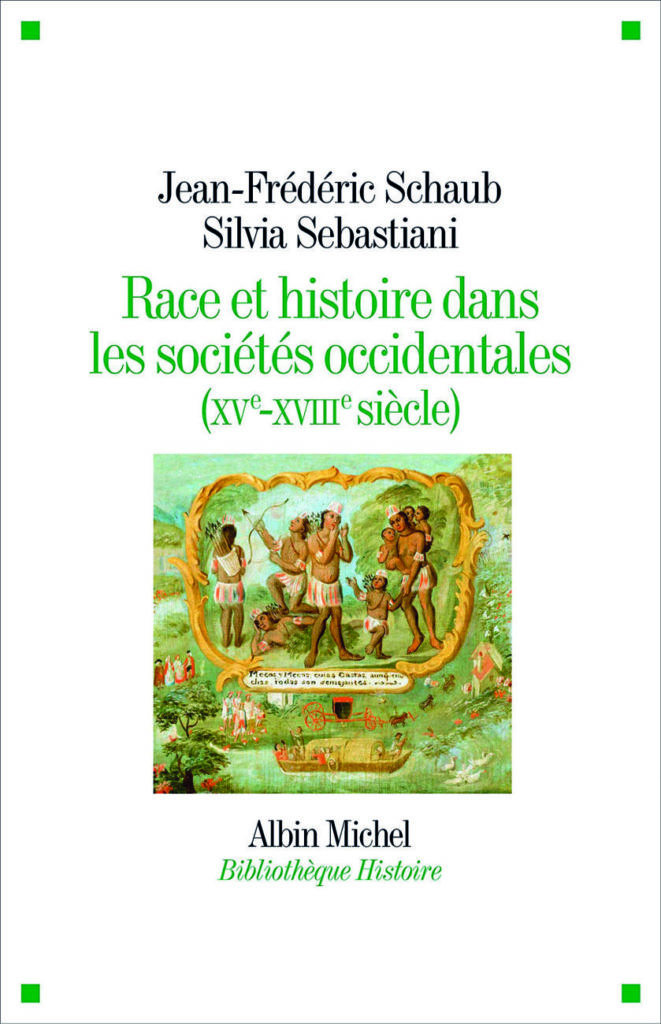
LIRE AUSSI > Pour une histoire de la discrimination « raciale »
SOUTENEZ LE DDV : ABONNEZ-VOUS À L’UNIVERSALISME
Achat au numéro : 9,90 euros
Abonnement d’un an : 34,90 euros