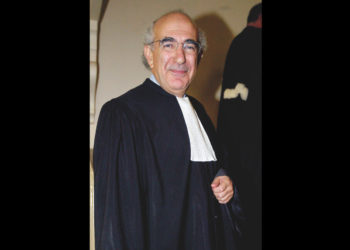Propos recueillis par Emmanuel Debono, historien, et Isabelle de Mecquenem, agrégée de philosophie
Entretien extrait du dossier « Avec ou sans les jeunes ? » paru dans Le DDV n°689, hiver 2022
Qu’est-ce qu’un « jeune » ?
Sur le plan légal, l’enfance va jusqu’à 18 ans. Sur le plan sociologique, on parle des « jeunes » pour la tranche 18 -29 ans, période qui est caractérisée par l’indépendance progressive puis l’entrée dans l’âge adulte, et marquée par plusieurs événements : la décohabitation du domicile parental, la conjugalité, l’entrée sur le marché du travail et le premier enfant. Il y a une trentaine d’années, ces événements survenaient de manière rapprochée et beaucoup plus tôt, autour de 25 ans. Aujourd’hui, ces étapes adviennent de façon plus déconnectée et, surtout, sont réversibles : des jeunes retournent chez leurs parents après avoir perdu un premier emploi, parfois avec leur conjoint ou leur compagne, éventuellement même avec des enfants. Sociologiquement, la définition de la jeunesse et de ses bornes d’âge change.
Les politiques publiques contribuent également à définir la jeunesse : en France, les jeunes ont droit à peu de prestations directes, celles-ci étant plutôt liées à la famille. C’est différent en Europe du Nord et, de fait, les jeunes y sont indépendants plus rapidement.
Le terme « jeunesse » renvoie-t-il à une réalité homogène ?
Il y a une homogénéisation des conditions de vie qui plaide pour dire qu’il existe une forme de cohérence en termes d’expériences, notamment autour du rythme et de la logique scolaires, qui organisent la vie des jeunes : mêmes horaires, programme d’enseignement unifié, mêmes attendus et bénéfices promis, etc. Mais homogénéisation ne signifie pas absence de logiques sociales : on sait, évidemment, que les enfants d’ouvriers réussissent moins bien à l’école que les enfants de cadres et que leurs expériences concrètes de l’école sont souvent bien différentes. De la même manière, les conditions de vie des étudiants, quels que soient leurs cursus, sont plus similaires entre elles, que celles d’un étudiant et d’un jeune qui travaille.
« Les jeunes sont de plus en plus porteurs de références culturelles extrêmement variées. Cette diversité culturelle consommée peut être liée au caractère multiculturel croissant de la population. »
Qu’appelle-t-on « cultures juvéniles » ?
L’expression sert à désigner le rapport à la culture d’un groupe d’âge. Certains comportements sont des communs générationnels : un goût pour l’écoute de musiques, la lecture de mangas, le visionnage de séries télévisées, pour la photo et la vidéo, et une distanciation par rapport à la lecture de livres. Mais au-delà de ces communs, on note des différences : les jeunes ne regardent pas tous les mêmes séries ni n’écoutent la même musique… Les garçons aiment particulièrement plus le rap, les filles, plutôt le hip-hop et la pop. Les catégories supérieures, plus l’électro, et les milieux populaires, le rap. Par ailleurs, les types de sociabilité dans les grandes villes, avec une offre pléthorique en équipements culturels, ne sont logiquement pas les mêmes qu’en milieu rural.
Va-t-on, justement, avec les plateformes numériques, vers une homogénéisation de ces cultures ?
Non, jamais. Sur les plateformes il y a une multitude de produits différents. Comme pour n’importe quelle autre génération, 80 % de la consommation se porte sur des produits « stars » ; les 20 % restants se portent sur une myriade de produits de niche…
Par ailleurs, les jeunes sont de plus en plus porteurs de références culturelles extrêmement variées. Cette diversité culturelle consommée peut être liée au caractère multiculturel croissant de la population – un jeune sur cinq a une ascendance étrangère en France, soit directe, soit par les grands-parents –, ce qui fait que les références et les appétences culturelles de l’ensemble de la population se diversifient. On peut y trouver des vertus extrêmement positives en termes de cosmopolitisme, de tolérance, de connaissance de l’autre… mais aussi critiquer les usages de cette ouverture souvent aussi utilisée comme un outil de stimulation consumériste (à travers le marketing de la différence, du nouveau, de l’exotique). Il n’en reste pas moins que cette ouverture, réalisée via les industries culturelles, n’est pas soutenue par un discours institutionnel qui considère le plus souvent les consommations des produits des industries audiovisuelles et numériques comme relevant du loisir non éducatif. Il y a certainement quelque chose à inventer en réinsérant l’éducation buissonnière que les jeunes se fabriquent à travers leurs consommations médiatiques dans le cadre d’une éducation artistique et culturelle pleine et entière.
Il existe, de fait, une tension entre ce cosmopolitisme et le modèle républicain…
Sur Netflix, beaucoup de séries asiatiques et américaines prônent le multiculturalisme comme projet sociétal. La diversité raciale, de sexe, de croyance, de milieu, etc., est valorisée en soi, notamment parce qu’elle est un argument marketing pour toucher des publics cibles.
Le multiculturalisme de la juxtaposition des communautés, à l’anglo-saxonne, donne à l’État un rôle minimal de régulateur de la coexistence de ces communautés. Cela a peu à voir avec le modèle républicain français, intégrateur et peu soucieux de la diversité des cultures, qu’il considère comme relevant de l’espace privé.
« Dans un monde où nos affiliations culturelles deviennent de plus en plus importantes pour nous définir comme individu, l’enjeu de la définition des communs culturels est absolument central. »
La culture a donc une incidence sur leur vision de la société, du monde, sur leurs options idéologiques…
Évidemment. Que consommait-on à leur âge ? De la musique et des films français et anglo-saxons. De la BD franco-belge et quelques comics. Notre monde culturel suivait les contours de l’Occident et de ses valeurs et normes, à quelques exceptions près.
Les jeunes générations tournent davantage leur regard vers d’autres régions du monde, et notamment l’Asie. Elles regardent des dessins animés japonais et dévorent des mangas. Elles sont fans d’anime et de jeux vidéo. Depuis le tournant des années 2010, la pop coréenne fait partie de leur univers culturel. À travers ces produits, ils s’imprègnent de normes culturelles nouvelles : une certaine vision du courage avec le Bushido [le code de conduite des samouraïs, ndlr], une certaine vision des relations entre les hommes et les femmes, qui n’a rien à voir avec l’amour courtois, une vision aussi de la place de l’individu dans le collectif, avec une place très importante donnée à la famille.
Certes, les jeunes consomment toujours beaucoup de produits américains, ces derniers étant dominants sur les marchés culturels que les jeunes affectionnent et ayant établi des standards de qualité aux yeux d’un grand nombre d’entre eux. Mais ils le font avec un discours critique sur les États-Unis bien plus fort que naguère, notamment parce qu’ils expriment le souhait d’un monde multipolaire et développent une aversion pour l’hégémonie culturelle, quelle qu’elle soit.
Comment l’école peut-elle se positionner par rapport à tout cela ?
L’institution scolaire est dans une situation très complexe, avec une population de plus en plus diverse, et la difficulté de transmettre un bagage de savoirs et de valeurs communs. Elle est chargée de tous les enjeux : éduquer les jeunes, les préparer au monde de demain, retisser le lien social, réinsérer, solidifier la démocratie en formant des citoyens éclairés, etc. Les objectifs se cumulent et s’éloignent de son champ de compétence et de sa mission initiale, et cela crée des tensions sur sa raison d’être et son efficacité. On le voit, le sujet est brûlant et mène aussi aux rêves de retour en arrière, à un « âge d’or » – dont le port de l’uniforme semble être le signe de ralliement –, mais dont on oublie qu’il s’agissait d’une école pour une faible proportion des cohortes d’enfants, relativement homogène sur le plan sociologique et culturel. L’école de masse dans une population de facto multiculturelle est bien différente. Dans un monde où nos affiliations culturelles deviennent de plus en plus importantes pour nous définir comme individu, l’enjeu de la définition des communs culturels est absolument central.
Le numérique rend-il les jeunes passifs ?
Au contraire, les jeunes produisent aujourd’hui des choses de manière complètement banalisée, au quotidien. Ils produisent de l’image, du son, de la vidéo, du discours, qu’ils mettent en ligne, partagent et échangent. On ne faisait pas ça à leur âge ! Alors oui, bien sûr, dans leurs productions, tout n’est pas de qualité ; mais de la même manière que lorsque nous écrivions notre journal intime ou faisions de la musique (pour ceux qui l’ont fait), nous n’avions pas tous – loin s’en faut – des qualités littéraires ou musicales. Mais ces pratiques incarnent la force de l’individualisme expressif de l’individu contemporain.
Mais on ne mettait pas forcément tout en ligne…
C’est vrai, c’est la différence. Aujourd’hui, on peut facilement tenter de trouver un public pour ses productions sur l’Internet. Mais ne nous leurrons pas : l’abondance de l’offre fait que la probabilité d’être vu est très faible.
Reste que les réseaux permettent à des amateurs de gagner en professionnalité en soumettant leurs créations au jugement critique des publics ou des experts. Sur une plateforme comme Wattpad, des écrivains amateurs postent leurs écrits : ces derniers sont lus par des amateurs, abondamment commentés. Ils peuvent même être repérés par des maisons d’édition.
Quand on parle de démocratisation culturelle, l’endroit où elle a eu lieu le plus, c’est peut-être dans ces pratiques d’amateurs, sous l’effet de la facilité croissante de prise en main des outils avec le numérique (on peut tout faire ou presque avec un simple smartphone et presque tout apprendre avec un tuto), de l’élévation des niveaux de diplôme (ce qui produit une population aux appétences culturelles croissantes) et de la valorisation de la créativité et de l’expressivité (qui augmentent la part des praticiens en amateur).
Qu’en est-il de l’engagement politique ?
Dans l’« ancien monde », à l’époque du Live Aid, des artistes s’organisaient pour lever des fonds et mobilisaient des fans. Aujourd’hui, c’est très différent : les fans s’auto-mobilisent. Internet donne des capacités d’action et d’expression très rapides. Les formes de leurs engagements se sont déportées sur l’Internet : ils y organisent des collectes de fonds, des pétitions, y font du lobbying via les hashtags, etc.
« Les jeunes sont portés par un désir de construire un futur dans des termes différents. Et leurs choix inquiètent car ils remettent en question la manière dont les sociétés occidentales ont fonctionné depuis les deux derniers siècles. »
Les cultures juvéniles font-elles émerger des causes mobilisatrices ?
Émerger je ne sais pas, mais elles s’en emparent, assurément. La reconnaissance des droits des personnes LGBT par exemple. Les questions environnementales bien sûr : le goût pour le vintage se développe afin de ne pas alimenter l’industrie du textile qui est la plus polluante au monde. L’attrait du végétarisme est aussi assez fort, par souci de l’environnement et préoccupation de la souffrance animale. Bien sûr, on peut toujours objecter que l’usage permanent du téléphone portable est contraire à ces engagements, parce que les systèmes de refroidissement des serveurs numériques sont parmi les plus gros pollueurs.
Néanmoins, les jeunes sont portés par un désir de construire un futur dans des termes différents. Et leurs choix inquiètent car ils remettent en question la manière dont les sociétés occidentales ont fonctionné depuis les deux derniers siècles, notamment autour de la démocratie représentative, qui suppose une confiance dans la représentation, dans les institutions politiques, dans le débat public et dans la possibilité d’un futur meilleur. On note par exemple chez eux une baisse de la participation politique, une défiance dans les institutions et le personnel politique, des interrogations fortes sur le fait de fonder une famille et d’avoir des enfants, une valorisation de la décroissance, etc.
Ils sont donc aussi dans la contradiction…
Quelle génération ne l’est pas ? On l’a vu à l’occasion du Mondial de foot au Qatar : de nombreux adultes se mobilisaient contre cette Coupe du monde pour des raisons environnementales et liées au non-respect des droits humains, mais comme l’équipe de France est allée jusqu’en finale, ces mêmes personnes ont regardé les matchs.
« La croyance dans le progrès, technique, médical et social, qui a été très forte dans les générations de la seconde moitié du XXe siècle, qui a fondé notre pacte social, est fortement mise en doute par les générations nées au XXIe siècle. »
Les jeunes ont des demandes qui peuvent être contradictoires. Certains ont envie de consommer et ne trouvent pas normal que leur vie s’annonce moins facile sur le plan matériel que celle de leurs aînés. D’autres pensent que c’est la décroissance qui est la solution.
Par ailleurs, chaque génération fait l’inventaire, à charge, de ce que la génération précédente a fait et lui lègue. Il y a notamment une fracture autour de la croyance dans le progrès, technique, médical et social, croyance qui a été très forte dans les générations de la seconde moitié du XXe siècle, qui a fondé notre pacte social, et qui est fortement mise en doute par les générations nées au XXIe siècle. De fait, les jeunes générations font un inventaire à charge des legs des générations du baby-boom et des générations suivantes (d’ailleurs se faire traiter de « boomers » est une critique dans leur bouche), au motif que ces générations ont été celles de l’hyper-consumérisme. Mais cette critique acerbe oublie que ces générations de l’après-guerre jusqu’aux années 1990 ont aussi été celles de la conquête de certains droits, notamment pour les femmes et les minorités sexuelles.
Ce que je trouve très compliqué quand on parle des transformations générationnelles, c’est que chacun parle depuis la génération à laquelle il appartient. Il est très difficile de se décentrer et pourtant c’est nécessaire pour comprendre les transformations sans jugement hâtif.
Comment les jeunes ont-ils vécu la crise sanitaire ?
Ils ont payé un lourd tribut parce qu’ils ont été privés de la vie sociale qui fait la vie juvénile. Beaucoup, dans les grandes villes, se sont trouvés enfermés dans des conditions matérielles déplorables, ayant perdu les petits boulots qui leur permettaient d’assurer un revenu, une expérience professionnelle mais aussi des contacts sociaux.
Les sociétés occidentales on fait le choix de protéger les personnes âgées pendant cette période. Ce fut un choix de société décidé dans l’urgence, sans qu’il y ait possibilité d’un débat collectif, un choix violent car fait de multiples restrictions à nos libertés. Le président de la République a d’ailleurs affirmé que nous étions en guerre. Les jeunes ont pu avoir le sentiment d’être sacrifiés. D’ailleurs, de nombreux signaux d’alerte ont été activés pendant et après les confinements avec une augmentation des comportements dépressifs, des décrochages universitaires.
Les ailleurs désirables de la pop culture
Qu’ont en commun le groupe de pop BTS et la série Squid Game ? Tous deux appartiennent à la nouvelle vague de produits culturels sud-coréens, connue sous le nom de Hallyu, qui déferle sur le monde et surprend par l’engouement qu’elle suscite.
K-pop, soft power et culture globale, le premier ouvrage en langue française consacré au sujet, montre comment cette pop culture, fruit de l’écosystème politique et économique sud-coréen, mise sur l’exportation massive de produits culturels à l’esthétique innovante. En s’appuyant sur ces leviers de soft power, la Corée du Sud promeut une globalisation culturelle alternative à l’hégémonie américaine et japonaise dans le domaine des imaginaires juvéniles.
À travers de nombreux entretiens, les deux auteurs, Vincenzo Cicchelli et Sylvie Octobre, analysent la ferveur des jeunes fans français, qui ne s’appuie sur aucune proximité culturelle préexistante, témoigne d’une nouvelle ouverture esthétique et les autorise à imaginer des ailleurs désirables, par-delà les assignations de genre, de classe ou d’origine.
Vincenzo Cicchelli est maître de conférences à l’Université de Paris, chercheur au Ceped (Université de Paris/IRD) et chargé de cours à Sciences Po.
Sylvie Octobre est chargée d’études au ministère de la Culture (Deps-Doc), chercheuse au Centre Max Weber et chargée de cours à Sciences Po.
Vincenzo Cicchelli et Sylvie Octobre, K-pop, soft power et culture globale, Presses universitaires de France, 2022, 324 p., 22 €.
LIRE AUSSI > Frédéric Dabi : « La génération Z ne veut ni le pouvoir ni le contre-pouvoir »
SOUTENEZ LE DDV >> ABONNEZ-VOUS À L’UNIVERSALISME
Achat au numéro : 9,90 euros
Abonnement d’un an : 34,90 euros