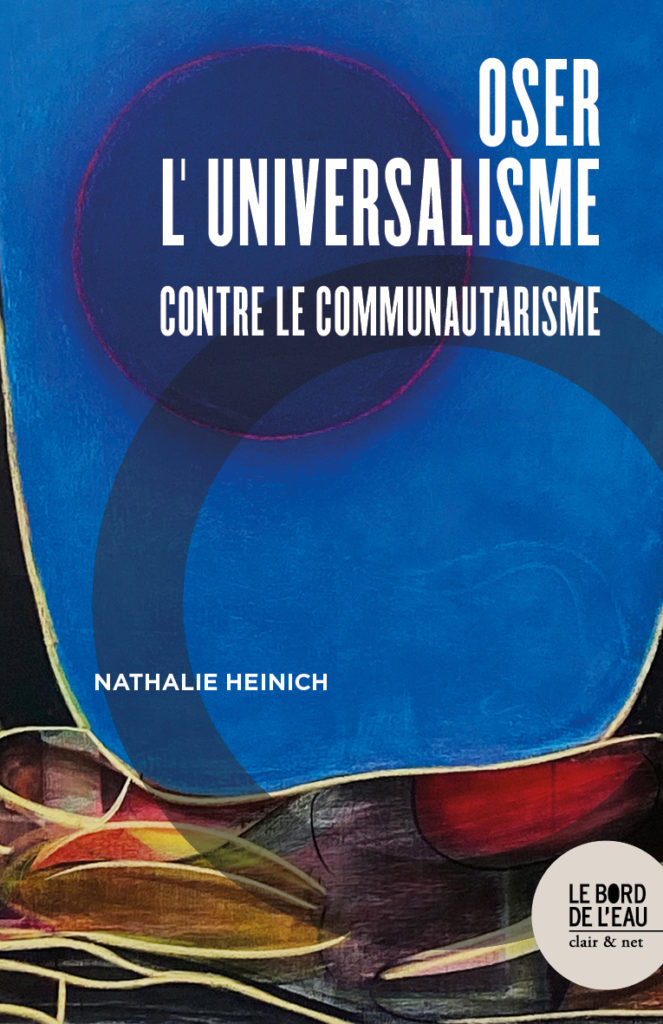Propos recueillis par Philippe Foussier
Entretien paru dans Le DDV n°685, hiver 2021 (numéro offert à télécharger)
Vous identifiez les trois marqueurs d’une conception communautariste de la société – en opposition à l’universalisme – que sont l’identitarisme, le néo-féminisme et les nouvelles censures. En quoi l’identitarisme et le néo-féminisme procèdent-ils d’une même logique communautariste ?
Ce que j’ai nommé l’« identitarisme » (« identity politics » en anglais) consiste à réduire les individus à une supposée « identité » assignée par l’appartenance à un groupe informel, ou « communauté », défini par des propriétés dont l’individu n’est, pour l’essentiel, pas responsable : identité de sexe (ou « gender », devenu « genre » dans le vocabulaire « académo-militant » de la dernière génération), d’origine ethnique (ou « race », terme revenu brutalement dans le vocabulaire militant après en avoir été banni car trop connoté « raciste »), d’orientation sexuelle, de religion, voire de handicap, etc. En associant ces « identités » à un statut de victime étant donné les « discriminations » qu’elles peuvent susciter, cette mentalité à la fois victimaire et communautariste enferme autoritairement les individus dans des cases étanches, ne tenant pas compte des différents contextes ni de la capacité des personnes à mettre en avant tel ou tel paramètre identitaire selon les situations. L’identitarisme se décline ainsi en néo-féminisme s’agissant des discriminations sexistes, en « décolonialisme » s’agissant des discriminations racistes, en « intersectionnalité » s’agissant du croisement des deux, en « lutte contre l’homophobie » s’agissant des discriminations sexuelles, etc.
Sous quelle forme cette dénonciation communautariste des discriminations peut-elle se traduire politiquement ?
En imputant la responsabilité de ces discriminations à des entités abstraites (« la société », « le patriarcat », « la domination », « le pouvoir », « l’État »), ce discours alimente une haine des institutions publiques, de l’État de droit, bref de tout ce qui peut représenter le « pouvoir » (la police, l’Éducation nationale, les élus, etc.), accusé de pratiquer un « racisme systémique » et, plus généralement, de maintenir une « domination » systématique, qui opposerait implacablement les « dominants » (mâles blancs hétérosexuels, etc.) aux « dominés ».
Comment expliquez-vous le surgissement de cette vogue communautariste ?
Cette mentalité communautariste, et la vision du monde à la fois agonistique et figée qui va avec, a trouvé son terrain d’élection dans la conception anglo-américaine de la citoyenneté, qui définit et traite les individus en fonction de leur « communauté » d’appartenance : ce pourquoi son importation en France doit beaucoup à l’influence des campus et des réseaux militants nord-américains (états-uniens mais aussi canadiens). Il y a là, probablement, un effet de mode, amplifié par les gratifications faciles que procurent aux esprits faibles le pouvoir de culpabilisation d’autrui issu de ces formes de victimisation, que résume le terme de « grievance studies » (« études geignardes »). C’est pourquoi identitarisme et néo-féminisme nous viennent directement d’Outre-Atlantique, au rebours de la tradition universaliste qui a longtemps caractérisé la gauche française, ainsi que le féminisme universaliste de la grande époque, il y a deux générations, qui mettait en avant la nécessité de suspendre la différence des sexes pour parvenir à l’égalité plutôt que de l’affirmer en toutes circonstances (comme tente de le faire l’écriture inclusive, qu’il vaut mieux nommer d’ailleurs « écriture excluante »).
La « cancel culture » vient également tout droit d’Outre-Atlantique…
Elle nous vient, comme son nom l’indique, de la culture américaine, pour une raison simple : lorsque l’État ne peut contraindre légalement la liberté d’expression, comme c’est le cas aux États-Unis et au Canada, alors ce sont des groupes de pression qui s’emparent du travail de censure, sans aucune légitimité démocratique. Au contraire la tradition française permet de brider légalement l’expression publique des opinions (en cas de diffamation, insulte, incitation à la haine, etc.), ce qui ôte toute légitimité – heureusement – aux tentatives de faire taire autoritairement ceux dont l’opinion nous déplaît. Malheureusement ces subtilités juridiques sont ignorées des nouveaux militants (rebaptisés « activistes », là encore par imitation de la culture américaine), qui s’estiment autorisés à annuler ou effacer ce qui ne correspond pas à leur vision du monde, à déboulonner des statues appartenant au patrimoine public, etc. Donc, là encore, nous assistons à l’importation sauvage de pratiques nord-américaines, faites à la fois d’ignorance, d’hubris et de culpabilisation à outrance, le tout sur fond de « théologie de l’éveil » (« woke ») à connotations fortement religieuses.
Vous assimilez les pratiques de ces nouvelles censures à un totalitarisme. Pouvez-vous expliquer en quoi ce qualificatif vous semble justifié ?
Les milices fascistes et les groupuscules nazis qui pratiquaient l’interdiction par la menace voire la violence physique, contre les personnes et contre les livres (avec les autodafés), n’étaient pas très différentes – seulement un peu plus violentes – que ces nouveaux militants tellement persuadés de porter la vérité du monde qu’ils ne voient pas la filiation autoritariste de leurs comportements, qui refusent d’admettre qu’ils pratiquent la censure de fait, et que le monde qu’ils voudraient nous imposer est à l’opposé de la délibération démocratique, de la prise en compte de la diversité des contextes, de la notion même de liberté d’expression, etc. Comme ils semblent assez ignares en matière de culture historique, on peut les considérer comme des « M. Jourdain » du totalitarisme : ils font du fascisme dans le savoir – voire, pour certains, en brandissant leurs convictions « antifa » pour mieux exaucer leur désir de toute-puissance sur autrui.
Vous identifiez plusieurs critiques adressées à l’universalisme : son manque de prise avec la réalité, l’idée selon laquelle il s’agirait d’un point de vue occidentalo-centré, celle encore qui l’accuse d’être le « communautarisme » des dominants et enfin sa prétendue négation de la diversité humaine. Comment répondre à ce quadruple réquisitoire ? Et comment résister à l’emprise du communautarisme alors même que, comme vous le montrez, il s’oppose à la fois à la liberté, à l’égalité et à la fraternité ?
J’ai essayé dans l’introduction de ce recueil de donner des « éléments de langage » permettant de mieux défendre la conception républicaine de la citoyenneté : universaliste, laïque, attachée à la liberté d’expression, à l’égalité des droits, à la mise en avant de ce qui nous lie plutôt que de ce qui nous sépare. Mais nous nous heurtons, d’une part, à l’inculture de nombre de ces nouveaux militants, qui ne voient pas que l’ambiance qu’ils cherchent à installer dans l’université et la culture ressemble furieusement à la période stalinienne d’il y a deux ou trois générations ; et d’autre part, à une évidente fracture générationnelle, qui rend le dialogue extrêmement difficile avec une grande partie de la jeunesse, que les réseaux sociaux (ou plutôt « ragots sociaux ») biberonnent à la doxa « activiste » venue des États-Unis.
La liberté n’est-elle donc qu’une transition entre deux dictatures – celle des régimes autoritaires d’un côté, celle des groupes de pression de l’autre ? Espérons qu’à force de refuser le chantage victimaire de ceux qui ne voient dans le monde que discriminations et domination, nous parviendrons à réduire ce phénomène à ce qu’il est, c’est-à-dire une crise d’adolescence mal négociée – et qu’il n’aura pas fait, entre temps, trop de dégâts sur les mœurs, les esprits et les lois…