Propos recueillis par Philippe Foussier
Entretien paru dans Le DDV n° 686, printemps 2022
Le propos général de votre livre, Dans le silence de l’État. Comment l’impuissance publique livre la société à elle-même, consiste à assurer que l’État n’est pas en voie de disparition mais qu’il s’est tu. Qu’entendez-vous par là ?
Le dépérissement de l’État, qu’annonçaient aussi bien, quoique dans des perspectives opposées, le marxisme et le libéralisme, ne s’est pas produit : l’État est toujours là, en droit, en forces, en moyens matériels et plus encore en moyens humains. Il délivre des prestations, il autorise ou interdit, etc. Mais il est composé depuis toujours, c’est-à-dire depuis l’avènement de sa forme moderne à la fin du Moyen Âge, d’une dimension symbolique par laquelle il fonde sa légitimité à agir. Or c’est cette dimension symbolique, ce rôle « d’instituteur de la société » comme je l’appelle, qui est aujourd’hui défaillante.
Que l’État soit l’opérateur de notre commun, que dépende de lui la fabrication d’une unité collective qui n’existe pas dans la société telle qu’elle est, et que cette opération politique, qui n’est rien d’autre que la poursuite du bien public, nous soit profondément nécessaire, voilà une idée qui est désormais sérieusement battue en brèche.
Vous analysez les rapports de l’État avec la société depuis plusieurs siècles. Quelles leçons en tirez-vous ?
Que la part de contingence l’emporte toujours sur la nécessité. On s’inquiète – à fort juste titre – des tensions dans la société française, voire des risques de guerre civile, mais je rappelle qu’au moins une fois par siècle depuis le Moyen Âge, et le plus souvent deux, la France s’est trouvée déchirée, ou défaite militairement, ou en proie à de grandes catastrophes climatiques ou sanitaires. Ce qui m’importe est la réponse que le politique tente d’apporter dans ces moments de doute et de péril ; d’où la question de l’État.
« Le besoin de se légitimer par un passé mythifié n’est pas nouveau et il se manifeste de façon particulièrement intense en ce moment, signe d’une tension évidente dont le rapport conflictuel à l’État est l’un des signes. »
J’observe les moments où l’on s’est efforcé de construire un « récit national », comme à la fin du XIXe siècle. Ce sont, évidemment, des reconstructions a posteriori, qui tracent un continuum qui débute par le baptême de Clovis et doit conduire à la reconquête de l’Alsace-Lorraine. Ce besoin de se légitimer par un passé mythifié n’est pas nouveau – ainsi le mythe vivace, jusqu’à la Renaissance, d’une ascendance troyenne de la France – et il se manifeste de façon particulièrement intense en ce moment, signe d’une tension évidente dont le rapport conflictuel à l’État est l’un des signes.
La construction de l’État en France est également tributaire de ses rapports avec les cultes. Que nous enseigne cette histoire-là ?
L’historiographie républicaine nous a un peu formatés à l’idée que l’État monarchique et l’Église marchaient main dans la main pour opprimer le peuple ; c’est évidemment plus complexe que cela, de même qu’il serait excessif d’affirmer, à l’inverse, que l’État s’est construit contre la puissance de l’Église. L’opposition frontale, c’est plutôt entre le Saint-Empire et Rome qu’on la trouve, car il y avait de part et d’autre une prétention au royaume universel ; tel n’est pas le cas avec le royaume de France, au projet d’envergure à la fois plus modeste, mais aussi plus radical : établir une légitimité propre, indépendamment de l’Église car fondée par le lien direct entre Dieu et le souverain. Ainsi la dynastie capétienne ne conteste pas à Rome ce que Pierre Legendre appelle « la Référence », c’est-à-dire la « loi des lois » d’où la société tire sa raison d’être : elle se l’approprie carrément, arrachant à l’Église le monopole de son interprétation. On n’est pas encore dans une logique de séparation, mais bien de prédation !
« Les “valeurs” de “vivre-ensemble”, pour le moins flottantes et insaisissables, qui se confondent largement avec celles du marché, sont loin d’épuiser notre besoin de sens. Les propositions identitaires viennent combler ce manque. »
C’est pourtant cette matrice qui est au principe de l’idée laïque, bien longtemps avant que celle-ci ne trouve une formulation politique et juridique dans le cadre républicain. Il fallait d’abord que s’impose l’idée d’un ordre politique qui est à soi-même sa propre fin. Une bascule considérable s’opère cependant, tandis que l’État monarchique se consolide : le transfert de la « Référence » ou, si l’on préfère, de la source de toute souveraineté, de Dieu vers le peuple. C’est ce que Machiavel théorise le premier, et qui place les sociétés européennes devant une question toute neuve, qui est celle de la représentation.
Vous identifiez un retour de la « Référence » religieuse dans la manière de conduire les affaires publiques. Que revêt cette notion ?
Le silence de l’État est un silence sur ce qui nous fonde : qui sommes-nous et que faisons-nous ensemble ? Alors que les penseurs du libéralisme classique étaient imprégnés de cette question, disons morale – à savoir : qu’est-ce qui peut pousser les hommes à s’associer les uns aux autres, au-delà de leurs intérêts ? –, la société de marché telle que nous la connaissons et la vivons aujourd’hui la renvoie à une pure affaire de détermination individuelle, ou de consensus par essence provisoire sur des « valeurs » de « vivre-ensemble » pour le moins flottantes et insaisissables… Or ces valeurs, qui se confondent largement avec celles du marché, sont loin d’épuiser notre besoin de sens. Les propositions identitaires viennent combler ce manque ; elles offrent une alternative à la « dissolution des repères de la certitude » dont parle Claude Lefort à propos de la modernité.
« Ce que j’ai essayé de caractériser dans mon livre, et qui me paraît constituer un vrai tournant historique, c’est que les élites, à nouveau, se retournent contre l’État. »
L’État est souvent mis en accusation, parfois pour son impotence, d’autres fois pour son impuissance ou au contraire son omnipotence. Finalement, qui défend encore l’État ?
Personne et… presque tout le monde ! Notre rapport à l’État est essentiellement ambivalent, fait de demandes toujours plus pressantes, mais aussi, « en même temps », d’un profond désir qu’il nous f…te la paix. On peut, si l’on veut, attribuer cela au caractère français. Ce que j’ai essayé de caractériser dans mon livre, et qui me paraît constituer un vrai tournant historique, c’est que les élites, à nouveau, se retournent contre l’État. C’est vrai des élites économiques, qui mettent en procès une bureaucratie coûteuse et inefficace ; mais c’est vrai aussi, et là réside la vraie nouveauté, des élites intellectuelles qui dénoncent un État liberticide. Et c’est vrai enfin des élites politico-administratives elles-mêmes, qui désertent de plus en plus tôt le service de l’État ou pratiquent plus volontiers un mélange des genres autrefois jugé avec la plus grande sévérité, et qui n’hésitent plus à considérer que leur plus haut devoir n’est pas de servir les intérêts de l’État, mais de les limiter au maximum. De ce point de vue, les coupes dans les effectifs de la police et de l’école, le démantèlement de l’État territorial et la création d’agences technocratiques à l’efficacité pour le moins douteuse durant la décennie 2000 auront caractérisé une véritable entreprise de démantèlement de l’État, conduite par une classe politique et des hauts-fonctionnaires convaincus qu’il fallait le réduire, pour ne pas dire le démolir.

Vous interrogez les procédures de la décision publique à travers le concept de co-construction ou le recours à la démocratie participative. Que nous disent-ils de l’évolution des rapports entre l’État et la société ?
Ces nouvelles modalités d’élaboration de la discussion et de la décision publiques se veulent un remède à la crise de la représentation politique « classique », dont l’épine dorsale est le processus électoral. L’objectif est-il atteint ? J’en doute : elles créent plutôt, me semble-t-il, une légitimité concurrente qui n’épaule pas le processus représentatif, mais contribue au contraire à l’affaiblir.
« On devrait se soucier de revaloriser la fonction élective. […] Veut-on que la classe politique devienne le terrain de jeu privilégié des médiocres et des fous furieux ? »
Pour ma part, il me semble qu’on devrait surtout se soucier de revaloriser la fonction élective. Exercer un mandat représentatif, diriger un exécutif, représente un engagement personnel très lourd. S’y ajoute désormais l’exposition à une violence qui a de quoi, légitimement, faire peur. Alors quoi ? Veut-on que la classe politique devienne le terrain de jeu privilégié des médiocres et des fous furieux ? Méfions-nous car nous sommes en réalité déjà engagés sur cette pente.
Vous analysez longuement les modalités de la décision publique sur le dossier de l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes. L’État est-il encore capable d’affirmer son autorité ou doit-il continuer à exister selon des modalités nouvelles ?
Voilà un projet engagé il y a plus d’un demi-siècle ! Je ne discute pas l’opportunité du projet lui-même, mais j’observe qu’études à l’appui, il a été considéré d’intérêt général, faisant l’objet d’un large consensus politique. Au fil des expertises, des concertations, des recours, et finalement des consultations, y compris référendaires, il serait difficile de dire que l’État a cherché à passer en force dans ce dossier. Et pourtant, l’État a fini par renoncer, devant quelques centaines de zadistes. Comment est-ce possible ? Parce que lorsque l’État montre sa faiblesse, il laisse les divisions s’installer et encourage le jusqu’au-boutisme. Qu’importe, encore une fois, le fond de l’affaire : l’abandon de Notre-Dame-des-Landes a donné un signal désastreux, celui d’un État Gulliver prêt à donner les cordes pour se laisser ligoter.
« Il faut assumer à nouveau la dimension spirituelle de l’exercice du pouvoir politique, c’est-à-dire affirmer le corps de valeurs autour desquelles nous nous rassemblons. »
Poids croissant des mouvements violents, protestations populistes, crise de la représentation mais aussi défiance des élites, que vous nommez les « Grands ». Comment l’État peut-il s’extraire de ces phénomènes ?
En reprenant patiemment le fil de sa propre histoire : d’abord reprendre en mains le contrôle du territoire, car le cours des choses produit des déséquilibres insupportables, du dépérissement des petites villes aux cités ghettos en passant par la désertification médicale ; ensuite en « abaissant l’orgueil des Grands », selon l’expression de Richelieu, et en faisant en sorte que se reforme une élite dévouée à l’intérêt public et non à ses intérêts propres ; enfin, ce qui est sans doute le plus difficile à faire, assumer à nouveau la dimension spirituelle de l’exercice du pouvoir politique, c’est-à-dire affirmer le corps de valeurs autour desquelles nous nous rassemblons.
Vous consacrez de nombreux développements aux problématiques identitaires ainsi qu’à la question de l’insécurité. Que nous disent-elles de l’État aujourd’hui ?
Elles signalent le vide que laisse l’État par son mutisme ou son inaction. Il n’y a rien d’étonnant au fait que ce soient essentiellement au sein des classes populaires que ces problématiques se fassent entendre : ce sont elles qui ont besoin de l’État.
« Si tant de fonctionnaires se sentent aujourd’hui démunis, c’est parce qu’on ne leur dit pas clairement quel est le sens de leur mission. »
D’aucuns ont pu identifier une France « archipellisée ». L’État est-il outillé pour répondre à cette évolution que ces analystes estiment d’ailleurs assez récente ?
L’État dispose des structures et de l’expertise, mais il est désorganisé et sans boussole. Je reste marqué par cette interpellation d’un directeur d’ARS [agence régionale de santé] lorsque j’enquêtais pour le compte du ministère de l’Intérieur sur les politiques locales en faveur de la laïcité : « Quelle est la ligne du parti ? » Bonne question… Au fond, si tant de fonctionnaires se sentent aujourd’hui démunis, c’est parce qu’on ne leur dit pas clairement quel est le sens de leur mission. Alors, ils font avec, ils bricolent, souvent avec astuce et presque toujours avec dévouement. Mais ce système D a quand même des limites : à un moment donné, il faut un cap, une direction. Et cela, seule la tête peut l’indiquer.
« La crise que nous connaissons aujourd’hui n’est pas plus grave ni plus profonde que la plupart de celles que le pays a traversées. La première des choses à faire est justement de ne pas céder au déclinisme, qui est un défaitisme déguisé en une fausse lucidité. »
Affaiblissement, désagrégation, affaissement, déclin, dessaisissement, démembrement de l’État… Vous pointez l’ensemble de ces phénomènes. L’impuissance publique livre-t-elle la société à elle-même de manière inéluctable ?
Pas du tout ! Je le répète : la crise que nous connaissons aujourd’hui n’est pas plus grave ni plus profonde que la plupart de celles que le pays a traversées. La première des choses à faire est justement de ne pas céder au déclinisme, qui est un défaitisme déguisé en une fausse lucidité. Nous n’avons besoin de rien d’autre qu’un peu plus de courage et de méthode.
LIRE AUSSI L’identité n’est pas une politique
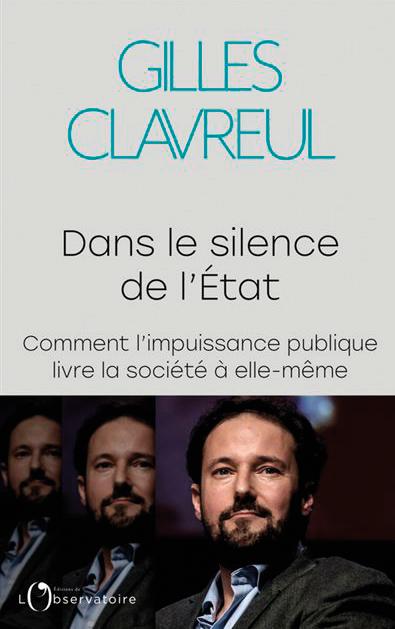
Éditions de L’Observatoire, 330 p., 21 €.


















