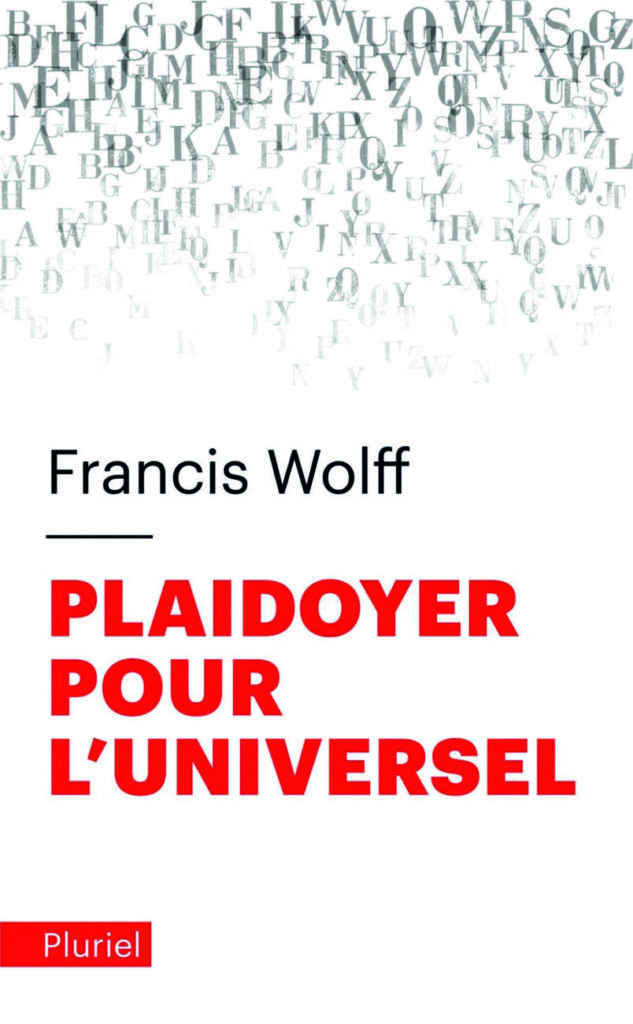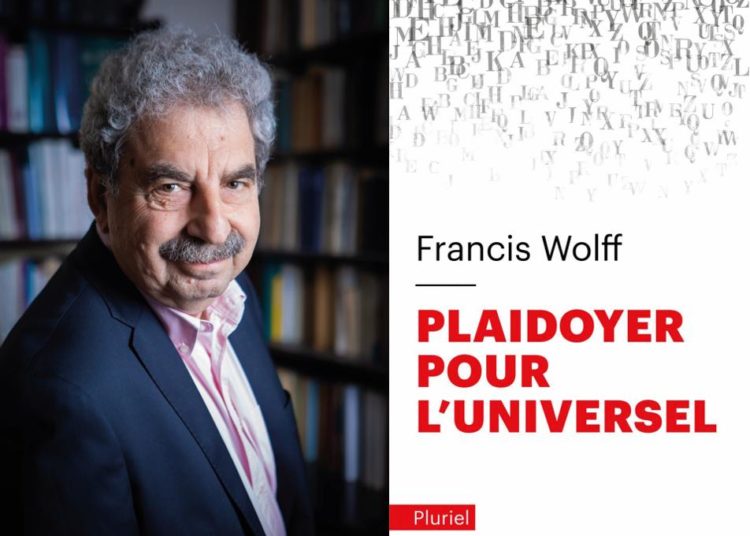Propos recueillis par Mikaël Faujour
Entretien paru dans Le DDV n° 687, été 2022
Dans Plaidoyer pour l’universel : fonder l’humanisme, une de vos analyses surprend car elle dépasse l’opposition communément admise entre universalisme et relativisme : « D’un côté, l’humaniste se doit d’être relativiste : il admet l’humanité dans toute sa diversité et variété […]. Mais d’un autre côté, l’humaniste est nécessairement anti-relativiste : il se doit de condamner les pratiques “barbares” ou inhumaines en usage dans telle ou telle collectivité humaine. On pourrait appeler ce conflit : le dilemme moral de l’ethnologue. » En quoi ce dilemme consiste-t-il ? Et que répondez-vous à ceux qui considèrent que l’universalisme nie le particulier ?
Il y a en effet un dilemme pour tout humaniste. D’un côté, il prend conscience que ses propres croyances ou coutumes n’ont aucune valeur absolue et qu’elles dépendent de l’éducation, de l’histoire, des sociétés, etc. De l’autre, il doit condamner les pratiques de certaines sociétés qu’il juge inhumaines, notamment parce qu’elles sont contraires à l’idée d’égales valeur et dignité de tous les êtres humains. De nombreux ethnologues se sentent réellement pris dans ce dilemme, par exemple face aux pratiques d’excision des fillettes dans les sociétés qu’ils étudient. Faut-il les respecter au risque d’encourager la domination et les souffrances de celles qui y sont soumises ? Ou les condamner au risque d’apparaître comme l’Occidental sûr de lui et dominateur, transgressant son devoir de neutralité scientifique ?
Quel est donc le « bon » relativisme culturel ? Distinguons deux plans : toutes les croyances se valent en tant que croyances ; mais il y a des savoirs qui ne relèvent pas des croyances, par exemple le savoir scientifique, les preuves rationnelles, etc. Toutes les coutumes existent, mais certaines sont contraires à l’idée d’humanité – idée qui n’a rien d’« occidentale » comme on le dit souvent, mais qui est présente dans toutes les sociétés et à toutes les époques.
« On croit à tort que chaque peuple, chaque société constitue une culture, et que tous les êtres humains sont enfermés dans leur culture. C’est faux. Là où il y a esclavage, servage, domination des femmes, il y a aussi des êtres qui s’indignent, se révoltent, même si c’est là la culture dominante. Je dis que ces hommes ou ces femmes sont porteurs de l’universel et des valeurs humanistes. »
Au plan théorique, je distingue deux usages du concept de « culture ». L’un est légitime : la culture est un ensemble de traits matériels et intellectuels sanctionnés par la tradition, typiques d’un certain mode de vie, enracinés dans une langue, une religion, etc. En ce sens, le relativisme culturel est justifié : de fait, il n’y a rien d’universel. D’un autre côté, on croit à tort que chaque peuple, chaque société constitue une culture, et que tous les êtres humains sont enfermés dans leur culture. C’est faux. Là où il y a esclavage, servage, domination des femmes, il y a aussi des êtres qui s’indignent, se révoltent, même si c’est là la culture dominante. Je dis que ces hommes ou ces femmes sont porteurs de l’universel et des valeurs humanistes.
Quel rapport établissez-vous entre l’indignation et l’universalisme ?
L’indignation est l’émotion humaine, purement humaine, par laquelle nous réagissons face à une injustice qui ne nous touche pas personnellement. Si nous sommes traités injustement, nous éprouvons de la colère ou du ressentiment. Lorsque nous avons été injustes, nous éprouvons de la culpabilité ou de la honte. Mais lorsque la justice concerne deux êtres humains inconnus de nous, nous en sommes indignés. C’est le signe que nous nous pensons impliqués dans des relations universelles d’égalité et de réciprocité avec tous les êtres humains.
Pour vous, le logos est le propre de l’homme, c’est-à-dire à la fois la raison et le langage. Vous vous référez plus spécifiquement à l’interlocution qui, écrivez-vous, « repose […] sur trois conditions formelles : chacun peut dire et penser “je”, et en effet s’adresser à n’importe qui (universalité), en le considérant, parce qu’il lui dit “tu” (réciprocité), comme un autre “moi” (égalité) ». Cette dimension se résume dans l’universalité de la « rationalité dialogique ». Qu’est-ce que cela signifie et implique ?
La spécificité de l’homme n’est ni le raisonnement (des machines raisonnent mieux), ni le langage (de nombreux animaux peuvent communiquer entre eux), mais la faculté de raisonner en parlant, c’est-à-dire d’argumenter, de justifier ce qu’on pense et ce qu’on fait. Chaque être humain peut s’adresser à tout autre en le considérant comme un sujet capable de le comprendre, de l’approuver ou de le désapprouver. Le « oui » et surtout le « non » sont propres à l’homme. Ils impliquent qu’on accorde de la valeur à l’approbation de son interlocuteur et, de proche en proche, à tous les interlocuteurs possibles lorsqu’on justifie ses actions par des valeurs, quelles qu’elles soient. Car toutes les valeurs ont une prétention à l’universalité.
« La barbarie, c’est de ne reconnaître qu’une seule manière de penser et d’agir, autrement dit ses propres valeurs. La civilisation est ce que j’appelle une “valeur de deuxième ordre” : la capacité pour une communauté à admettre en son sein la pluralité des valeurs et des cultures. »
L’universalisme, écrivez-vous, postule l’existence de l’humanité en tant que communauté éthique, une communauté d’égaux ; d’où découle une éthique de la réciprocité universelle. En quoi consiste-t-elle ? Et pourquoi est-elle universelle ?
Si nous étions réduits à ce qui fait la spécificité humaine, c’est-à-dire au logos, et donc dénués de toutes passions et émotions, nous formerions une communauté éthique. Nous appliquerions dans nos relations des relations de réciprocité selon les règles suivantes : nul n’agressera les autres à condition que tous en fassent autant ; chacun s’efforcera d’aider les autres, à condition qu’ils en fassent autant ; et plus généralement : chacun s’efforcera de traiter tout autre comme il voudrait être traité par lui. Ces règles sont universelles parce qu’elles sont à l’avantage de chacun et de tous ; et surtout parce qu’elles ne dépendent pas du caractère des uns ou des autres. Les égoïstes les appliqueraient par égoïsme (ou par intérêt) et les altruistes les appliqueraient par altruisme (ou par empathie). L’universalisme postule que l’humanité est une telle communauté. Il définit l’idéal éthique que nous devons viser.
Vous avancez que « sont antihumanistes toutes valeurs qui empêchent l’existence d’autres valeurs, donc la diversité des valeurs ». Vous écrivez aussi : « Sont ainsi civilisés, au sens moral, ces moments historiques, ces espaces géographiques, ces aires culturelles ou ces communautés qui permettent la coexistence, de fait comme de droit, de diverses communautés – voire leur copénétration réciproque et leur compréhension mutuelle. Une civilisation est riche d’une pluralité virtuelle ou réelle de cultures diverses tandis qu’une communauté est barbare lorsqu’elle ne peut être qu’elle-même […]. »Comment articulez-vous la disposition humaniste à accueillir l’altérité – chez autrui comme à l’intérieur de soi-même – avec l’universalisme ?
Dans ce texte, je voulais m’opposer à toute définition substantielle de l’opposition civilisation/barbarie. On a toujours tendance en effet à accuser l’autre de barbarie ; et l’Occident, lui-même auteur de tant de crimes et de massacres, se prend souvent pour détenteur de l’universel. On est partagé entre le fait de condamner cette opposition (ce qui nous ferait retomber dans un relativisme anti-humaniste) et le fait de ne pas savoir quel sens lui donner. Je la redéfinis de façon formelle. La barbarie, c’est de ne reconnaître qu’une seule manière de penser et d’agir, autrement dit ses propres valeurs. La civilisation est ce que j’appelle une « valeur de deuxième ordre » : la capacité pour une communauté à admettre en son sein la pluralité des valeurs et des cultures. Dans le même ordre d’idées, la laïcité n’est pas une religion, c’est la possibilité de coexistence de divers religions ou croyances – donc une valeur de deuxième ordre. Et la tolérance n’est pas une conviction, c’est la possibilité de la coexistence de diverses convictions. En étant tolérant, je ne renonce nullement à la vérité absolue de mes propres convictions et je n’ai aucune raison de reconnaître la valeur de vérité de celles d’autrui ; mais j’ai toutes raisons de reconnaître la valeur d’une communauté où nous pouvons coexister – et sa supériorité par rapport à toute communauté où une telle diversité serait impossible.
« Il ne faut pas confondre l’universalisme avec l’uniformité : il n’est pas la négation de la diversité culturelle, mais au contraire sa condition d’existence. »
Pourquoi estimez-vous que « [l]’universel […] est notre seul point fixe et assuré dans le chaos des valeurs »?
Parce que l’homme est cet être capable d’agir au nom de valeurs – au-dessus de ses propres intérêts et de sa vie même. C’est là sa grandeur ! Mais c’est aussi sa perte ! Car ceux qui au péril de leur vie sauvent des centaines de migrants d’une mort certaine le font au nom de valeurs ! Mais ceux qui se font exploser au milieu d’une foule en causant des centaines de morts le font aussi au nom de valeurs. Au pays des valeurs, c’est la guerre, et toute guerre (par exemple celle d’Ukraine) est une guerre de valeurs. C’est ce que j’appelle la tragédie des valeurs et il n’y a a priori aucun moyen de trancher. Y a-t-il donc une ou des valeurs universelles ? Ma réponse est oui, mais elles n’ont pas de contenu particulier, elles sont formelles : égalité morale de tous les humains et réciprocité de leurs relations, valeurs de deuxième ordre de diversité et de coexistence, etc.
En quoi le cosmopolitisme vous semble-t-il non seulement s’articuler à l’universalisme, mais être la réponse à une « globalisation [qui] menace la diversité culturelle sans laquelle il n’y a pas d’humanité » et « les faux refuges dans des identités imaginaires antagoniques »?Ce qui revient à poser aussi la question, complémentaire : en quoi le cosmopolitisme est-il contraire à ladite globalisation ?
Dans un livre précédent [Trois utopies contemporaines, Fayard, 2017], j’ai soutenu que, dans un monde déserté par les utopies politiques, une seule était à la hauteur des enjeux globaux et des risques planétaires, c’est l’utopie cosmopolitique : devenir citoyens du monde. Cet idéal me paraît le meilleur antidote aux replis nationalistes et xénophobes ainsi qu’aux dangers des politiques de l’identité. La sécularisation a fait de nous des individus aux identités mouvantes et métissées. Pour le pire : l’individualisme. Et pour le meilleur : l’universalité des droits des personnes. Mais il ne faut pas confondre l’universalisme avec l’uniformité : il n’est pas la négation de la diversité culturelle, mais au contraire sa condition d’existence. Les différences ne peuvent exister que si elles sont garanties par un universel de second niveau, comme je viens de le rappeler. L’universalisme est donc l’opposé de la globalisation économique et culturelle. Et le cosmopolitisme repose à la fois sur une éthique de l’égalité des personnes et sur une politique des différences de culture.
LIRE AUSSI > Daniel Bernabé : « Le néolibéralisme a confondu la différence et l’inégalité »