Propos recueillis par Emmanuel Debono, historien, et Isabelle de Mecquenem, agrégée de philosophie, directrice adjointe du Réseau de recherche sur le racisme et l’antisémitisme
Entretien paru dans Le DDV n° 688, automne 2022
Comment appréhendez-vous la proposition de résolution déposée mi-juillet à l’Assemblée nationale par une trentaine de députés de la gauche française accusant l’État d’Israël d’« apartheid » et d’« actes inhumains » envers le « peuple palestinien »?
Il est important, je crois, d’annoncer d’emblée « d’où je parle ». Je suis résolument opposé à la colonisation des territoires occupés, que je considère une triple abomination – morale, légale et politique – et un partisan de toujours de la création d’un État palestinien souverain aux côtés de l’État d’Israël.
C’est dire qu’il ne faut pas être un annexionniste excité pour trouver que la proposition de résolution que vous évoquez est un texte scélérat. Mépris de l’Histoire, hémiplégie intellectuelle et morale, amalgames sulfureux et approximations scandaleuses, rien n’y manque. Ce libelle long de vingt-deux pages et truffé de références érudites est tellement caricatural, tellement haineux, que nombre de membres de la Nupes, qui l’a porté sur les fonts baptismaux, s’en sont désolidarisés. L’un de ces « Justes », le communiste Christian Picquet, en a dit l’essentiel dans son blog le 26 juillet. J’en recommande chaudement la lecture.
La résolution se fonde sur le rapport d’Amnesty publié le 1er février : « L’apartheid israélien envers le peuple palestinien. Un système cruel de domination et un crime contre l’humanité ». Mais que désigne « Israël » dans ce discours très univoque qui semble méconnaître la pluralité des voix politiques émanant de la société israélienne ?
Apparemment, tous les Israéliens, colombes et faucons confondus. Et l’État d’Israël tout entier, l’État juif tel qu’il est né juridiquement d’une résolution des Nations unies, et, historiquement, des décombres de la Shoah. Cet État s’est fourvoyé depuis la guerre des Six Jours. Soulagé d’avoir échappé à l’annihilation annoncée, et, pour une part croissante de ses citoyens, ravi d’avoir recouvré le cœur historique de l’ancien Israël, il s’est installé dans ses conquêtes. Peu à peu, l’engrenage inexorable des régimes militaires l’a emporté sur les velléités de l’occupation « libérale » voulue par Moshe Dayan. Dans la Cisjordanie occupée, rebaptisée à l’ancienne « Judée-Samarie », où coexistent deux populations inégales de fait et de droit, un système d’apartheid s’est effectivement mis en place – apartheid non pas racial mais ethno-juridique, mais apartheid quand même.
« Drôle de régime d’apartheid où les Arabes siègent à la Cour suprême, servent comme diplomates, peuplent les universités et les hôpitaux, et, bien sûr, élisent leurs représentants à la Knesset. »
Rien de tel, bien entendu, de ce côté-ci de la Ligne verte1La Ligne verte est une ligne de démarcation entre Israël et les pays voisins, tracée en 1949, à la fin de la guerre israélo-arabe de 1948., où, malgré des discriminations, la démocratie israélienne assure à ses citoyens arabes la plénitude des droits formels. Drôle de régime d’apartheid où les Arabes siègent à la Cour suprême, servent comme diplomates, peuplent les universités et les hôpitaux, et, bien sûr, élisent leurs représentants à la Knesset, l’un de leurs partis ayant d’ailleurs intégré la coalition gouvernementale. À l’évidence, les penseurs de la Nupes ne se sont pas embarrassés de ces nuances.
Les députés préconisent notamment le boycott des produits israéliens, et réclament un embargo strict sur l’armement, incluant toutes les armes et munitions, alors que nous sommes en période de risque de guerre mondiale. Quelles sont selon vous les intentions d’une telle résolution ?
Je ne suis pas certain que les promoteurs du projet de résolution aient réfléchi aux conséquences d’un tel embargo ni qu’ils en souhaitent vraiment les effets. Il faut faire la part de la rhétorique. Mais il est vrai que la rhétorique fait froid dans le dos par ce qu’elle sous-tend de rejet de la légitimité de l’État juif. Et comment ne pas relever que ce sont les mêmes qui ont les yeux de Chimène pour la Russie de Poutine…
Ce texte a-t-il eu un écho en Israël ?
Peu à vrai dire, bien moins qu’en France en tout cas. Comme toujours, c’est la droite qui en a fait ses choux gras. Pour elle, c’est un beau cadeau. Il en va toujours ainsi, ce genre de déclaration sert de « preuve » que le monde en général et la gauche en particulier sont irrémédiablement antisémites et que la seule attitude convenable à l’égard de ces gens-là est le défi.
À y regarder de plus près, tout le monde ne donne pas exactement la même définition au terme « antisionisme ». Quel sens et quelles réalités recouvrirait la vôtre ?
Comme le sionisme lui-même, l’antisionisme est pluriel. Rappelons d’abord qu’il y a eu, et qu’il y a toujours, un antisionisme juif. Pour les différents courants de l’ultra-orthodoxie, la prétention à créer un État juif sur la terre d’Israël par des moyens politiques, autrement dit sans intervention divine, s’apparentait à un péché monstrueux. L’ultra-orthodoxie contemporaine est l’héritière de cette conception. À l’autre bout du spectre culturel en diaspora, communistes et bundistes rejetaient le sionisme au nom de l’internationalisme prolétarien. Pour ceux-là, le nationalisme, tout nationalisme, était un obstacle à l’avènement d’une société sans classe ; pour ceux-ci, seule était envisageable une autonomie culturelle et territoriale au sein d’une société régénérée ; pour tous, l’antisémitisme était une survivance barbare d’une histoire aliénée, dont la révolution émancipatrice était censée signer la fin. La variante libérale de cet antisionisme préétatique, surtout répandue en Occident, comptait, elle, sur le progrès des Lumières pour en finir avec la judéophobie. Enfin, les élites juives d’Europe occidentale et des États-Unis se sont opposées au sionisme, soit au nom d’un diasporisme censé représenter le génie particulier du peuple juif, sa façon d’être au monde, soit, plus prosaïquement, de peur que le mouvement national juif ne portât atteinte au statut civique des juifs de leurs pays. Le goulag et la Shoah ont largement eu raison de l’antisionisme juif.
Il y a, ensuite, ce qu’on pourrait appeler un « antisionisme de situation ». C’était le cas du monde arabe et islamique. De plus en plus, cet antisionisme-là s’accommode fort bien de l’acceptation explicite du fait national israélien, à condition (et encore !) qu’il fasse une place vivable au fait national palestinien. Tout Israélien qui a noué des relations fortes avec des Palestiniens comprend cette distinction.
« L’“antisionisme éradicateur”, autrement dit l’hostilité définitive, sans nuance ni rémission, à l’égard de l’État d’Israël, c’est la détestation d’Israël habillée en idéologie politique. »
Une autre variante est ce qu’on peut appeler un antisionisme « de réalisme géopolitique ». Celui-là sévissait, à partir de la grande révolte arabe de 1936-1939, au sein du gouvernement de Sa Majesté. Il s’agissait à l’époque de ne pas se mettre à dos le mouvement national arabe à un moment où se profilait la guerre contre l’Allemagne nazie. C’est cette attitude qui prévalait dans les ministères des Affaires étrangères, aussi bien à Londres qu’à Paris et à Washington. La reconnaissance de l’État d’Israël en 1948 a été décidée largement contre les diplomates, ceux que le président Truman appelait avec dédain les « garçons à pantalons rayés du département d’État ».
L’hostilité à Israël qu’exprime la proposition de résolution de députés de la Nupes ne s’inscrit pas dans de telles filiations…
Elle relève en effet d’un autre type d’antisionisme, « l’antisionisme éradicateur », autrement dit l’hostilité définitive, sans nuance ni rémission, à l’égard de l’État d’Israël. Cet antisionisme-là, c’est la détestation d’Israël habillée en idéologie politique. C’est une passion singulière. Généralement, les « ismes » nés de la révulsion à l’égard d’un mouvement particulier – l’antifascisme, l’anticommunisme, l’antiracisme, l’antilibéralisme –, ratissent large. On n’est pas antifasciste uniquement contre les manifestations du fascisme en France, par exemple. L’antisionisme, lui, est particulariste et monomaniaque : il vise une idéologie nationale unique, et, à travers elle, un État-nation et lui seul. Par ailleurs, le procès qu’il instruit contre cet État-nation ne s’intéresse pas à son régime politique, ni à son discours, ni même à ses actes, sinon hypertrophiées, mythifiés et déformées pour correspondre au canon du Mal absolu ; en dénonçant son idéologie fondatrice, il s’en prend à son essence même, jugée une fois pour toutes illégitime. Aussi le démantèlement pur et simple de cet État-nation serait-il un acte conforme à la marche de l’Histoire comme à la morale commune. Ceci est extraordinaire. Aussi monstrueux soient les crimes dont se rend coupable un peuple à tel ou tel moment de son histoire, la raison veut que l’on s’en prenne à son régime, pas au peuple, voire à l’État dont ce régime s’est emparé. Pour l’antisioniste éradicateur, en Israël, peuple, État et gouvernement ne font qu’un.
« À partir de la création de l’État d’Israël, et à moins de s’opposer à tout fait national au nom d’un principe cosmopolite supposé supérieur au tribalisme nationaliste, l’antisionisme perd toute justification rationnelle. »
Et, bien entendu, l’antisioniste éradicateur ignore la grande diversité du sionisme. De tout temps, il y eut des sionistes de gauche, du centre et de droite, des sionistes marxistes et des sionistes libéraux, des sionistes messianiques et séculiers, des sionistes libertaires et des sionistes fascistes. À ses yeux, ces distinctions, si tant est qu’il en a connaissance, ne sont rien. Seule compte la soupe indistincte du « sionisme », laquelle suffit à justifier son aversion.
Quel est le rapport de l’antisionisme à l’antisémitisme ?
Pour le gouvernement d’Israël, comme pour de larges pans de l’opinion juive et israélienne, toute manifestation d’antisionisme est de l’antisémitisme. À l’évidence, on l’a vu, l’équivalence n’est pas toujours pertinente. Il n’empêche, à partir de la création de l’État d’Israël, et à moins de s’opposer à tout fait national au nom d’un principe cosmopolite supposé supérieur au tribalisme nationaliste, l’antisionisme perd toute justification rationnelle. En effet, il ne s’agit plus de s’opposer à un projet, mais de contester la légitimité de ce qu’il a produit. L’État existe désormais, a été porté sur les fonts baptismaux par les Nations unies et se trouve de ce fait membre de droit de la communauté internationale. Dès lors, lui dénier cette qualité, l’ostraciser, proclamer sa scélératesse intrinsèque et affirmer sa volonté de le détruire, n’est rien d’autre que de l’antisémitisme déguisé sous des oripeaux jugés plus présentables.
Le 19 juillet 2018, la Knesset a adopté la « loi Israël, État-nation du peuple juif ». Cette « loi fondamentale » ne donne-t-elle pas raison à ceux qui évoquent la domination d’un « groupe national ethnique » et la volonté d’une « hégémonie démographique juive » ?
Cette loi, qui défigure la constitution de l’État juif, illustre la dérive nationaliste du pays. Dans sa formulation, elle n’a rien de scandaleux : que « le droit à exercer l’auto-détermination dans l’État d’Israël [soit] propre au peuple juif » est la vocation même de cet État. Cependant, outre son inutilité – car à quoi sert-elle, cette loi qui ne dit rien que l’on ne sût déjà, sinon à provoquer l’ire des citoyens arabes et justifier les pires préventions de nos adversaires ? –, le problème est non dans ce qu’elle dit, mais dans ce qu’elle ne dit pas. À rebours de la Déclaration d’indépendance, elle passe sous silence l’exigence d’égalité des citoyens – couverte, il est vrai, par une autre loi fondamentale, mais dont l’absence ici crève les yeux.
Vous avez été ambassadeur d’Israël en France de 2000 à 2002, au moment de la tenue de la très anti-israélienne conférence de Durban puis du déclenchement de la seconde intifada. Comment analysez-vous l’impact de tels événements sur l’accroissement des actes antisémites dans notre pays ?
Il y eut deux conférences, en fait, la conférence de Durban en Afrique du Sud en 2001 et, huit ans plus tard, à Genève, Durban II – deux pantalonnades lamentables qui ont abouti à l’inverse de ce qu’elles prétendaient accomplir, deux festivals grossièrement antisémites. À chaque fois, ulcéré, j’avais pris la plume pour dire dans tel ou tel quotidien tout le mal que j’en pensais. Depuis, force est de constater que la situation n’a fait qu’empirer. Seul changement notable : à la violence verbale de l’ultragauche s’est ajoutée la violence physique de la droite extrême, surtout aux Etats-Unis. Sans oublier le terrorisme islamiste, bien entendu.
Les opérations militaires s’enchaînent contre Gaza. En dépit de son rapprochement avec certains pays arabes, Israël demeure sous le feu de menaces immédiates. Comment sortir selon vous de cette situation impossible ?
Étrange situation : tous ceux qui disposent d’un cerveau en état de marche comprennent que la solution à Gaza n’est pas militaire, et pourtant on continue d’agir comme si elle l’était. Seuls ceux qui ont quelque chose à perdre réfléchissent à deux fois avant de le mettre en péril. Alors, ce qu’il est urgent de faire, c’est donner aux Gazaouis des raisons d’espérer. Il faut changer, non de tactique, mais de stratégie. Des plans ambitieux existent, il faut les mettre en œuvre.
« Je ne crois pas au virage brutal à droite qu’aurait pris la société israélienne. Le camp de la paix ne s’est pas volatilisé, il a été rendu muet par la violence insensée de la seconde intifada et le manque de perspectives diplomatiques. »
Évidemment, une solution temporaire à Gaza n’est pas la solution au conflit israélo-palestinien. Or, sur le « processus » censé y conduire, mieux vaut ne pas se faire d’illusions. Il faut avoir la foi chevillée au corps pour croire encore à un compromis historique avec les Palestiniens – selon l’Index de la paix publié en juillet par l’université de Tel-Aviv, nous sommes à peine 22 % à nous y accrocher.
Cela dit, refuser de voir la réalité ne veut pas dire qu’elle n’existe pas. À la longue, elle finit par s’imposer, qu’on le veuille ou non. Quelle forme prendra le dur réveil ? Une nouvelle intifada ? Un « tsunami diplomatique » selon la forte expression d’Ehud Barak ? Les deux, celle-ci suivant celle-là ? Nul ne le sait.
Comment la société israélienne réagit-elle à ce contexte ? Y perçoit-on des signes de radicalisation ? Y a-t-il des risques d’implosion ?
Contrairement à l’opinion commune, je ne crois pas au virage brutal à droite qu’aurait pris la société israélienne. Le camp de la paix ne s’est pas volatilisé, il a été rendu muet par la violence insensée de la seconde intifada et le manque de perspectives diplomatiques. Un centre amorphe où se trouvent la plupart des Israéliens se désintéresse tout bonnement de la question. Si radicalisation il y a, et elle est indéniable, elle concerne le camp national-religieux. Les marges fascisto-messianiques se sont déplacées vers le centre de l’échiquier politique ; des individus autrefois infréquentables par la droite nationaliste elle-même sont désormais courtisés et piaffent aux portes du pouvoir. En fait, nous connaissons une évolution à l’américaine : le Likoud s’est mué, comme le parti républicain là-bas, en une secte extrémiste dévouée à un démagogue. Et l’on ne dispose pas ici d’un Parti démocrate qui, malgré ses divisions, reste un grand parti de gouvernement. Le paradoxe ? Si la démocratie israélienne n’est pas au mieux de sa forme, elle se porte tout de même mieux que la démocratie américaine – on n’imagine pas ici une foule surexcitée partir à l’assaut de la Knesset, ni une Cour suprême aussi caricaturalement partisane, ni le conspirationnisme le plus échevelé au cœur du pouvoir. C’est une consolation…
Mémoires d’Élie Barnavi
Lorsque Élie Barnavi présente ses Confessions d’un bon à rien comme un essai d’ego-histoire, ce n’est pas par choix d’un courant porteur, mais en écho à la découverte à l’adolescence d’un événement familial refoulé qui le confronte directement à l’Histoire avec sa grande hache : la mort en déportation des deux premiers enfants du couple parental. Un fait traumatique qu’il condense en une saillie ironique au sujet de sa venue au monde en 1946 : « J’ai souvent pensé, et dit, que je suis né grâce à Hitler. »
Élevé d’abord dans la grisaille de la Roumanie communiste par un père qui fut officier de l’Armée rouge afin d’écraser les nazis et une mère au foyer glissant progressivement dans la folie, sa carrière le mène de l’université de Tel-Aviv à la politique internationale en tant qu’ambassadeur d’Israël en France au début des années 2000, avec une parenthèse à Bruxelles où il s’investit dans la création d’un musée de l’Europe à vocation de pédagogie politique.
Son brillant parcours intellectuel et politique d’Israélien de gauche, athée, sioniste, spécialiste des guerres de religion françaises, prônant la résolution du conflit israélo-palestinien par deux états légitimes, doit sans doute beaucoup à la fatwa scolaire prononcée par la proviseure de son lycée : « un bon à rien ».
Le dernier essai d’Élie Barnavi plonge dans l’Histoire globalisée qu’il incarne si bien, mais qu’il cherche à infléchir par son action et ses écrits, tout en confiant, lui, dont le nom hébreu signifie « fils de prophète », que l’avenir d’un « monde anomique et déboussolé » ne peut qu’être « indéchiffrable ».
Élie Barnavi, Confessions d’un bon à rien, Paris, Éditions Grasset, 2022, 512 p., 25 €.
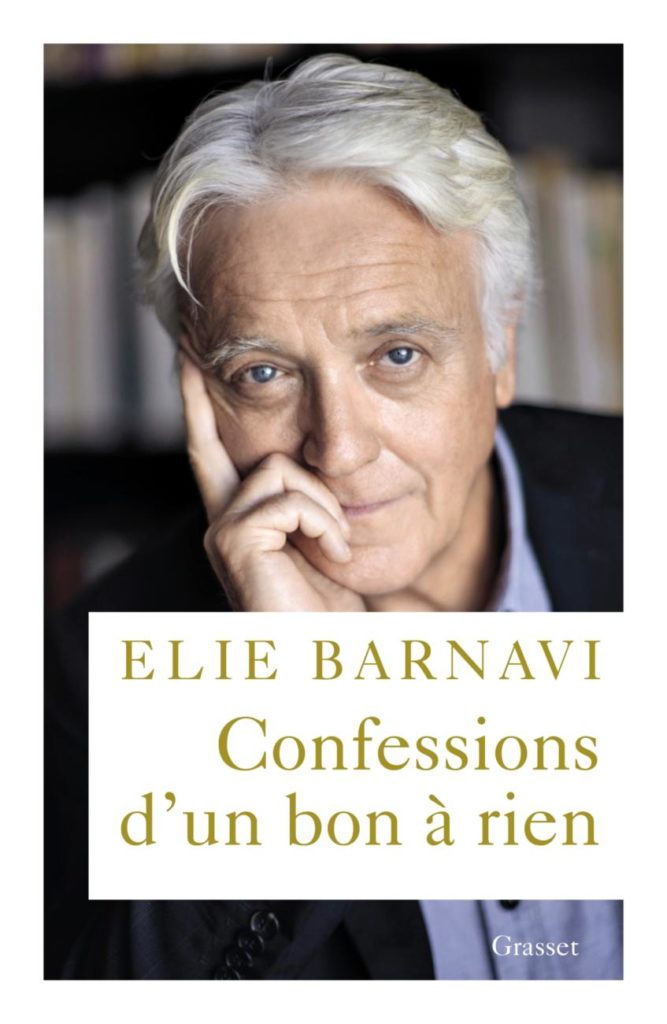
LIRE AUSSI >> Ce que nous sommes…
SOUTENEZ LE DDV >> ABONNEZ-VOUS À L’UNIVERSALISME
Achat au numéro : 9,90 euros
Abonnement d’un an : 34,90 euros


















