Propos recueillis par Mikaël Faujour, journaliste
Qu’est-ce qui a motivé l’écriture de cet essai ?
Un désir assez vieux disons : que les questions coloniales, décoloniales et postcoloniales s’affranchissent de cette logique hémiplégique dont l’hégémonie paralyse les débats. La controverse s’est trouvée anémiée par une disqualification systématique de toute pensée contraire. Une suspicion, surtout quand on est Africain, d’être à la solde d’une structure coloniale et fatalement d’être un félon à sa communauté. À l’inverse, en France, les termes de débats hystérisés par un débordement des conflits politiques et sociétaux sur le terrain universitaire et médiatique n’ont pas favorisé des échanges sereins et profonds qui me semblent nécessaire. Loin du « nuancisme » qui peut nous guetter – en effet cette tiédeur qui en remplace une autre et fait de la nuance un horizon quand il doit être un moyen –, ce désir, qui préside à la naissance de ce livre, est un rappel : les manichéismes confortables ne font que différer les explosions et nourrir les frustrations. C’est in fine un plaidoyer pour un débat intellectuel sans anathème et une rupture régénérative dans le récit décolonial pour explorer d’autres pistes paradigmatiques.
Le titre de l’essai est un jeu de mots, mais il fait aussi référence aussi à l’essai de Cynthia Fleury Ci-gît l’amer. Guérir du ressentiment. Pouvez-vous expliquer le choix de ce titre et dans quelle mesure il s’inscrit dans ses pas ?
Le titre est ironique, il m’a semblé que dans sa contradiction apparente, elle disait en peu de mots toute la séquence post-coloniale. Cynthia Fleury, dans une archéologie remarquable et une monographie fine, saisit une énergie triste, toute à sa violence végétative liée, qui irrigue de plus en plus des luttes politiques de révolte et d’émancipation. Par le tableau exhaustif qu’elle dresse, elle montre l’universalité d’un sujet qui permet de sortir de la compartimentation commode qui crée des centres et des périphéries. Cette intelligence de saisir la totalité me paraît une prouesse qui donne une clef de lecture du ressentiment. Elle propose aussi des pistes de réflexions pour en sortir. Les échos ont été vite évidents pour mon champ d’intérêt. L’amertume du ressentiment désaile les rêves d’émancipation et obstrue les possibilités d’insouciance sans lesquelles la création est orpheline, condamnée à la plainte perpétuelle qui avalise la défaite.
Les écrivains africains ont tous été accusés de duplicité, sinon d’être des agents de promotion de la colonisation, par ceux qui avaient défini un périmètre du « disable » ou du dicible, de l’acceptable – arbitrairement du reste. Sortir du récit décolonial et de ses obsessions équivalait à s’exposer à la furie des siens.
La première moitié du livre est consacrée à l’aliénation, notamment à travers les cas d’écrivains qui en ont subi le reproche. De quoi s’agit-il et en quoi cette généalogie de la « querelle puérile (…) des rebelles et des aliénés »éclaire-t-elle la question post- et/ou décoloniale présente ?
Pour faire court : les écrivains africains ont tous été accusés de duplicité, sinon d’être des agents de promotion de la colonisation, par ceux qui avaient défini un périmètre du « disable » ou du dicible, de l’acceptable – arbitrairement du reste. Sortir du récit décolonial et de ses obsessions équivalait à s’exposer à la furie des siens. Le front anti-occidental, étant fondateur dans la lutte pour l’émancipation, ne devait ainsi découvrir aucune fissure, même au prix du mensonge. La communauté présidait à la communauté de la pensée, en écrasant ainsi diverses nuances capitales, à même de ressourcer les positions figées. Le spectre de ce qui est salué par la communauté étant ainsi réduit à cette seule dimension, toute la pluralité des idées, le regard sur soi, l’inventaire des échecs et des responsabilités en l’occurrence africaines, se sont retrouvés victimes de cette optique solitaire et dictatoriale. Le résultat, c’est la querelle fratricide entre auteurs, pour une course au « plus africain », car le trophée à l’identité enracinée, purement africaine, était convoité comme le symbole de la résistance. Cette traque des aliénés est une triste chimère car, avec le temps, les chasseurs et les chassés permutent sur la roue de l’Histoire qui ne cessera heureusement pas de tourner pour confondre tous les adeptes de l’identité carcérale.
Vous montrez que la mise en accusation de celle-ci butte ironiquement sur les conditions de réussite (y compris d’idées hostiles à la France) : centralité culturelle de Paris, institutions de la francophonie et langue française. Pouvez-vous expliquer l’ambiguïté du « sentiment anti-français et anti-occidental », dans le rapport entre l’Afrique – ses intellectuels en premier lieu – et la France ?
Le sentiment anti-français est une commodité langagière qui couvre il me semble peu de choses de ce qui se joue actuellement. La lutte anticoloniale est une lutte juste, nécessaire ; elle n’a pas vocation à disparaître. Elle continue à structurer la contestation contre les institutions françaises et ce sentiment d’invasion dont les interventions militaires sont la locomotive. Rien en l’occurrence n’est singulier, les interventions partout, de n’importe quelle armée, n’ont pas bonne presse, elles sont un symbole colonial, quelle que soit par ailleurs leur urgence ou la demande des pays concernés. À ce titre, le discours panafricain, décolonial ou afro-centriste, s’inscrit dans une filiation politique qu’il ne faut pas expurger de son sens en en faisant l’expression de marionnettes russes. Mais il existe un ressentiment anti-français qu’exploitent plusieurs forces et la frontière n’est pas si étanche avec le premier élément, on y glisse d’un terrain à l’autre au gré des conjonctures. Et pour les intellectuels et artistes, ce ressentiment est tenace, car la France tant honnie a été le cœur de leur épanouissement. Comment, ainsi, composer avec le bourreau qui se trouve être le mentor ? Voilà l’équation et la question déchirante que beaucoup tranchent dans une radicalité de la posture dont on connaît les coulisses. Ce serait coûteux pour eux d’assumer pas seulement une identité francophone mais une identité française alors que c’est une des solutions – certes pas populaires – pour porter toutes ses influences. Il est illusoire d’être un usager d’une langue comme le français et considérer que cela n’a aucun impact. Toute langue est le véhicule d’une civilisation. Je ne trouve cela en rien infamant. La France cesse d’être ainsi pour moi une obsession ressentimentale. Je lui applique la même liberté de jugement, sans être ni un vassal, ni un ennemi.
Vous reprochez à la gauche « la perpétuation de ce regard apitoyé sur des sujets qu’elle n’arrive pas à considérer comme souverains hors du seul statut de victime de l’Histoire », effet d’une pensée consistant à attribuer les maux dont souffre l’Afrique au colonialisme. Comment expliquez-vous qu’une gauche, qui prétend le combattre, pratique une forme – impensée – d’occidentocentrisme en niant le statut de sujet aux Africains, c’est-à-dire une part de responsabilité ? Pourquoi la grille de lecture décoloniale/postcoloniale vous semble-t-elle déresponsabiliser et constituer l’« opération de rachat de virginité favorite » de tyrans ? Ce qui est pensé ici comme « de gauche »… favorise-t-il son contraire en Afrique ?
Ces diverses questions se recoupent. La gauche, au prix d’accommodements déraisonnables, a fait de l’anticolonialisme la frontière du progressisme. C’est avaliser inconsciemment l’idée d’un double standard : l’Occident, qualifié pour un progressisme érigé en symbole ; et un autre monde, où il serait permis, au nom de la lutte anticoloniale, de fermer les yeux sur les atteintes aux droits de l’homme. Les progressistes du Sud deviennent ainsi, au Nord, des « réactionnaires » pour les entomologistes de la morale de gauche. C’est un abandon triste, car les éclaireurs du Sud avaient comme interlocuteurs naturels la gauche et maintenant doivent se méfier des assauts de la droite et de son potentiel baiser de la mort. En trahissant ses valeurs, elle se cantonne à un rôle moral, qui du paternalisme bascule dans le maternalisme envers les minorités. Cette conception de l’autre dans la seule position de victime, dépolitise curieusement et relègue d’autres logiques comme la classe sociale, fondamentale pour comprendre ce qui se joue. Il existe des exemples nombreux dans l’histoire où la gauche, par cécité volontaire, bornée, idéologique, a pactisé avec le pire.
La gauche, au prix d’accommodements déraisonnables, a fait de l’anticolonialisme la frontière du progressisme. C’est avaliser inconsciemment l’idée d’un double standard : l’Occident, qualifié pour un progressisme érigé en symbole ; et un autre monde, où il serait permis, au nom de la lutte anticoloniale, de fermer les yeux sur les atteintes aux droits de l’homme.
Sur quels points convergez-vous avec les auteurs et militants postcoloniaux et décoloniaux ?
Sur la nécessité d’interroger sans cesse l’histoire et de combattre les hiérarchies sourdes et invisibles de la domination. La décolonialité est pour moi un moyen, pas une fin. On prend des outils pour des horizons. Voilà mon désaccord fondamental. Et il y a aussi le désir secret d’une hégémonie chez beaucoup de décoloniaux : on ne détruit pas les structures de la domination ; on veut en jouir pour aboutir à la revanche historique.
Les décoloniaux dénoncent souvent l’universalisme – souvent confondu avec des abjections auxquelles il a servi de prétexte en étant trahi. Vous semblez vous inscrire, quant à vous, dans l’universalisme critique d’un Frantz Fanon. Pourquoi et en quoi êtes-vous universaliste ? Et en quoi ce que vous nommez l’« incolonisable des peuples » est-il une manifestation de l’universel ?
L’universel comme l’expose Frantz Fanon dans la conclusion de Peaux noires, masques blancs est notre seul horizon. Toute colonisation échoue dans la subversion des cœurs. C’est la défaite originelle, du reste ; elle est porteuse d’espoir. L’incolonisable serait ce qui résiste, ce qui dans l’hybridation inévitable garde sa part vivace, c’est la co-construction de la modernité. Un art de vivre, une pause, une respiration, une série de différences, pas une opposition, un gisement pour réorienter. L’incolonisable ne sera pas un catalogue de recettes toutes prêtes, mais le questionnement de certains impensés, de puits inexplorés, pour redessiner d’autres optiques. Une archéologie offensive en somme. D’où l’importance de nourrir cette réflexion par une recherche réelle et des nuances multiples, hors du seul cadre théorique et de son surplomb potentiel.
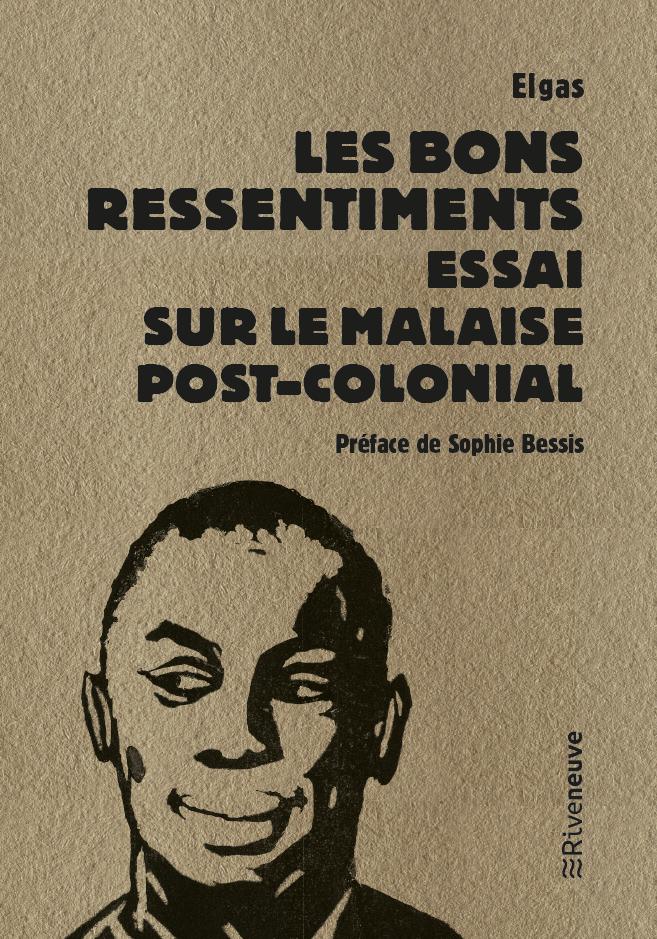
Elgas, Les bons ressentiments. Essai sur le malaise post-colonial, Paris, Riveneuve, 2023


















