Propos recueillis par Emmanuel Debono
(Article paru dans Le DDV n°681, décembre 2020)
DDV : Cette flambée raciste de 1973 commence-t-elle avec le meurtre de Ladj Lounès ?
Dominique Manotti : Contrairement à la légende qui veut que les ratonnades de l’été 1973 commencent après l’assassinat d’un traminot français par un immigré algérien fin août, elles ont débuté bien avant et sont très peu évoquées par les journaux de l’époque. J’ai voulu au moins rappeler les événements de Grasse du mois de juin 1973, la grève des travailleurs immigrés tunisiens, durement réprimée par la municipalité, qui se solde par plusieurs blessés graves.
Yvan Gastaut : Tout ne commence pas en 1973 en effet. Si on lit Minute dans les années 1960, on est confronté à ce racisme. On repère des faits divers dans la presse. 1971 est un moment un peu précurseur avec la nationalisation des compagnies pétrolières par Houari Boumédiène, qui occasionne des ratonnades. Il y a aussi des cafés qui refusent les clients maghrébins… La guerre d’Algérie s’est terminée peu auparavant, et « mal » terminée. Il faut en outre rappeler que les années 1960 sont marquées par une forte immigration en provenance d’Algérie.
D.M. : Cette fois-ci, comme bien souvent, ce sont des initiatives gouvernementales qui déclenchent la flambée raciste populaire. L’amnistie de l’Organisation armée secrète (OAS) en 1968 a pesé lourd. De nombreux amnistiés reviennent à Marseille et structurent les milieux pieds-noirs. On les trouve aussi dans cette organisation hallucinante des Soldats de l’opposition algérienne (SOA). Je ne l’ai pas inventée ! La première fois que je suis tombée sur cette organisation, je me suis dit, ce sont des fous ! Non mais vous imaginez ? Des gens appuyés par le Service de documentation extérieure et de contre-espionnage (SDECE), qui veulent reconquérir l’Algérie ? Ces types-là, on les voit réapparaître du côté de Marseille après l’amnistie. On trouve aussi des anciens de l’Algérie française à la tête du Service d’action civique (SAC), signe que la fracture au sein du gaullisme, entre partisans de l’Algérie française et partisans de l’indépendance, s’est résorbée. Et puis il y a les circulaires Marcellin-Fontanet, en 1972, qui accentuent le contrôle de l’immigration en rendant obligatoires la carte de séjour et la carte de travail, et ouvrent la porte à la campagne d’Ordre nouveau contre l’immigration sauvage. Enfin, il ne faut pas oublier qu’en 1973, Giscard est dans les tuyaux pour prendre le pouvoir, que Michel Poniatowski a des accointances avec l’OAS. Dans certains milieux, ça se sait.
Y.G. : L’extrême droite se structure avec Ordre nouveau et la naissance du Front national, en 1972. Le 21 juin 1973, il y a ce fameux meeting d’Ordre nouveau à la Mutualité avec comme slogan « Halte à l’immigration sauvage ! ». La ligue communiste vient affronter les participants et s’en prend à la police qui défend l’entrée de la salle. Le ministre de l’Intérieur, Raymond Marcellin, décide d’interdire à la fois la Ligue communiste et Ordre nouveau, ce qui met les deux camps sur le même plan. Les circulaires Marcellin-Fontanet suscitent par ailleurs une mobilisation des travailleurs immigrés eux-mêmes qui sortent du bois, comme c’est le cas du Mouvement des travailleurs arabes (MTA). Cette visibilité insupporte beaucoup de monde, et pas seulement l’extrême droite.
Marseille, c’est un cas particulier en France ?
D.M. : Il y a eu une cinquantaine de morts durant la période dans la France entière. Mais sur ces cinquante, beaucoup étaient dans le Sud.
Y.G. : Statistiquement, c’est vrai, le Sud a été très marqué. Cela a pu faire penser que le racisme était circonscrit à cette région, comme s’il y avait un territoire spécifique où il se développait. On a eu tendance à territorialiser le phénomène. Il y a eu aussi l’argument du « seuil de tolérance ». On a
dit : « C’est normal qu’il y ait du racisme à Marseille puisqu’il y a trop d’immigrés. » C’était une sorte de mécanique perverse consistant à considérer que le racisme naît là où il y a beaucoup d’immigrés. Ça n’était pas vrai, comme l’ont montré, a contrario, l’Alsace ou d’autres zones du territoire.


Avez-vous réécrit cette histoire ?
D.M. : J’écris des romans pour essayer de comprendre ce qui s’est passé. Je n’ai donc aucun intérêt à truquer les faits. J’écris sous leur contrainte. Les personnages, eux, sont imaginaires : je les construis en fonction des faits et de la situation, et je fais très attention à ne prendre que des personnages secondaires, ce qui me laisse toute latitude pour les faire vivre. Dans ce roman-là, j’ai un peu modifié la chronologie parce que je ne suis pas Tolstoï ! Je ne suis pas un auteur de la longue durée. C’est pour cela aussi que j’écris du roman noir : j’ai besoin d’un truc ramassé et de situations de crise. Dans la réalité, l’histoire s’étire davantage. Mais j’ai le sentiment de n’avoir rien trahi. J’ai condensé, changé un élément par rapport à un autre, mais sur le fond, je suis restée dans les clous.
On peut lire dans L’Express, le 2 juillet 1973, après les événements de Grasse : « Quelque chose de grave est en train de naître, qui porte un nom : le racisme. » Georges Gorse, ministre du Travail, affirme le 21 septembre 1973 : « La France n’a pas de tradition xénophobe. » Quant à Georges Pompidou, président de la République, il déclare le 28 septembre 1973 : « La France est profondément antiraciste. » Que penser de ces affirmations ?
Y.G. : Il y a une sorte de tournant en 1973, comme la levée d’un tabou. La presse en parle, comme si le racisme n’avait pas existé auparavant. Je crois que c’est la fin du déni de la Seconde Guerre mondiale, l’après-Vichy où l’on s’est dit que la France ne serait plus raciste, plus jamais en quelque sorte.
D.M. : Mais on disait aussi qu’elle ne l’avait jamais été ! Il a fallu attendre Paxton, qui a publié en 1972 La France de Vichy…
Y.G. : Il y a comme la concomitance de deux prises de conscience : celle des crimes de la Seconde Guerre mondiale et celle de la question du racisme anti-Arabes. Une question est alors souvent posée dans la presse : « Les Français sont-ils racistes ? » Cette prise de conscience peut d’ailleurs passer par le déni. Quand Pompidou déclare : « La France est profondément antiraciste », il pare à une accusation et donc, d’une certaine manière, il nourrit cette prise de conscience médiatique. Pendant toute la IVᵉ République et les années 1960, on a eu le réflexe d’étouffer les faits. Les seuls qui en parlent, ce sont Droit et Liberté (MRAP) et Le Droit de Vivre (LICA), c’est-à-dire la presse antiraciste. Les autres journaux sont très discrets.
Ce déni crée une tension…
D.M. : Oui, c’est vraiment pesant, la France paraît vivre dans un déni perpétuel. La référence à la valeur de l’universalisme semble surtout servir à dénier la réalité… Je vais vous dire, moi, ce qui a changé ma vie. Je viens d’un milieu très bourgeois et je n’avais vraiment aucune vocation à devenir syndicaliste en milieu ouvrier. Ce qui m’a changé, c’est la guerre d’Algérie. J’avais été élevée dans le culte de la République, dans une famille attachée aux Droits de l’Homme, à l’universalisme. J’ai 16 ou 17 ans, et je découvre que ma nation, ma grande nation, torture, déporte, que le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes n’est pas appliqué. Je ne comprenais pas comment on pouvait s’en réclamer et faire la guerre aux Algériens. Ça n’a pas été une petite chose la torture en Algérie ! On parle ces temps-ci de racisme systémique ; là, la torture a été systémique. Pour moi ça a été très simple : il fallait se battre contre la guerre en Algérie, pour l’indépendance de l’Algérie par tous les moyens. Pour moi, ça coulait de source. Mais je me suis aperçue par la suite que ce type de raisonnement était extrêmement minoritaire…
Vous vous méfiez des grands principes ?
D.M. : Oui ! Même si je reste intellectuellement attachée à l’universalisme et aux Droits de l’Homme. Mais je m’en méfie. Et c’est pour ça, en y réfléchissant, longtemps après, que j’aime le roman noir. Parce que dans le roman noir, dans la tradition américaine des années 1930, on ne s’intéresse pas à ce que disent les gens ou à ce qu’ils pensent. On s’intéresse à ce qu’ils font. Et le roman noir dit les choses telles qu’elles se font. Moi j’essaie de faire une littérature de ce que font les hommes, entre eux, en société. Leur vérité pour moi elle est là. Après, cette vérité, je peux la critiquer au nom de certaines valeurs mais il y a d’abord ce qu’ils font.
Et le « racisme d’État » ?
D.M. : Je ne sais pas quel est vraiment le sens de l’expression. Une chose est sûre, c’est que l’organisation de la police, sa gestion, peut conduire à une police raciste. J’ai beaucoup enseigné en Seine-Saint-Denis, j’ai suivi beaucoup d’affaires de bavures. On met les flics dans des situations impossibles. On leur donne des ordres, on les fait fonctionner sur un modèle qui induit nécessairement
du racisme.
Y.G. : Je pense qu’il n’y a pas de racisme d’État. L’État est raciste s’il organise une politique d’apartheid comme en Afrique du Sud, par exemple. On a pu approcher, à certains moments de l’histoire, une forme de racisme d’État, comme le 17 octobre 1961, ou en en 1973, avec une sorte de couverture de la part de l’administration. Il peut aussi y avoir des pratiques racistes induites par l’imaginaire de ceux qui sont dépositaires de l’autorité publique. Il y a eu par exemple l’affaire Diab, en 1972, où un immigré meurt tabassé dans un commissariat. Il y a eu des bavures, c’est vrai, mais l’institution policière ne se réduit pas à cela. C’est presque du complotisme que de considérer l’État comme raciste !
D.M. : Ce qui est une réalité à Marseille, en 1973, c’est que les anciens pieds-noirs intégrés dans la police ont tendance à se regrouper et à travailler ensemble, ce qui se comprend. Cela induit des comportements policiers semblables à ceux qui avaient cours en Algérie et la hiérarchie l’accepte.
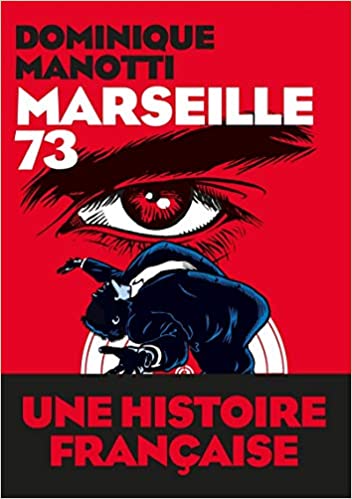

Il y a pour vous un héritage colonial ?
Y.G. : Il peut être en toile de fond, avec l’emploi de certains mots, par exemple, même si l’événement et l’expérience s’éloignent. C’est une référence qui reste un peu comme une forme de fantasme ou de ligne de mire. Je vois personnellement surtout des évolutions. Je ne veux pas faire d’angélisme mais les formes de discriminations aujourd’hui sont quand même moins lourdes.
Vous brossez, Dominique, le tableau d’une époque qui est d’une violence extrême ! On ne peut pas dire que c’était mieux hier, la France des années 1970…Il y a aujourd’hui de nombreux garde-fous contre ces dérives.
D.M. : Je pense justement que c’est en raison des changements que les réactions de certains sont plus violentes, un peu comme des réactions de « petits blancs ». Il est évident que c’est en train de changer. Quand j’étais gamine, moi, on n’aurait jamais vu ni un Arabe, ni un noir, servir dans un café. Pas de contact avec la clientèle. Et à mon avis, la crainte de l’intégration qui commence induit des réflexes inconscients de défense. C’est là, de mon point de vue, que se situe la « crise raciste » actuelle.
Pourquoi semble-t-elle si vive ?
D.M. : Ma génération a vécu le bouillonnement des années 1960 et un effondrement depuis les années 1980. Pourquoi a-t-on une remontée du racisme ? Parce qu’il n’y a plus de forces politiques à gauche, ni de réflexion de fond, à gauche, sur ces sujets. C’est la grande différence avec l’extrême droite qui elle a une pensée continue, enracinée notamment dans la guerre d’Algérie. L’axe central de la pensée et de l’action politiques de la gauche, c’est le changement de société. La lutte antiraciste s’articule sur cet axe. Mais cet axe central s’est effondré, il n’a plus ni profondeur ni cohérence, il est invisible, incompréhensible. Et l’antiracisme perd une base essentielle. J’ai arrêté de militer en 1981. Comme mon engagement politique et syndical s’enracinait dans la guerre d’Algérie, quand on m’a présenté François Mitterrand comme un homme de gauche, je n’y ai pas cru. Ce qui me fendait le cœur c’était l’enthousiasme populaire, réel. Il a scellé la fin de ce que j’espérais. Ça voulait dire que ce qu’on avait fait n’avait pas été compris, n’avait pas été reçu. C’était un constat de défaite.
Est-ce sans espoir ?
D.M. : Non, je ne le pense pas. Il y a depuis quelques années des manifestations massives des jeunes, sur l’écologie, contre le racisme avec lesquelles je me sens de fortes affinités, même si je suis réservée sur le « langage racialiste ». Vaste débat… Ceux que j’ai croisés disent volontiers : « Nous n’avons pas de références dans le passé, les “vieux” ne nous ont rien transmis. » Et c’est assez vrai. Prenons le Parti communiste. Il allait mal, ce qu’il pouvait transmettre ça n’était pas brillant, mais il n’a rien transmis du tout, il s’est effondré sur lui-même. Et qui a transmis quoi que ce soit ?
Y.G. : Surtout pas les socialistes !
D.M. : Qu’est-ce que vous voulez qu’ils transmettent ? La récupération de la Marche pour l’égalité et contre le racisme en 1983 a été un désastre. J’en entends tout le temps parler chez les jeunes. Ça, les parents l’ont transmis : « On s’est fait couillonner, on ne recommencera pas ! » Il y avait un élan incroyable dans la Marche pour l’égalité. Mais il a été récupéré par le PS…
Y.G. : C’est un peu le négatif de 1973. Dix ans après, en 1983, on parle des jeunes qui veulent être Français, qui révèlent une France plurielle. Tout devient possible. Ça ouvre une brèche, un souffle. Des portes ont été ouvertes, peut-être pas assez je suis d’accord… Mais « On n’a rien fait pour nous », il faudrait pouvoir dépasser cela. Des choses ont été faites ; la politique de la ville, ça a quand même existé.
D.M. : Oui mais on n’a pas mis cette population – et ça c’était déjà vrai dans les années 1970 avec les syndicats –, on ne l’a pas mise en situation de diriger les mobilisations. C’est à ce moment-là qu’il aurait fallu coaguler, quand il y avait des forces des deux côtés. On ne peut pas coaguler sur des défaites et des faiblesses.
Y.G. : SOS Racisme en son temps a tout de même apporté un souffle à la société française. C’est après coup que l’on voit, comme vous dites, la couillonnade. Je ne suis pas pour encourager l’excuse du « on ne nous a rien transmis » : c’est dénier à l’individu son autonomie. À 25 ans, il faut prendre les choses en main…
D.M. : C’est ce qu’ils font ! « Racisé », c’est un terme que moi je ne peux pas employer. Toute mon histoire, c’est le refus de la référence à la race. Mais en même temps, il faut reconnaître que c’est très difficile de trouver des mots adaptés aux situations actuelles. Aujourd’hui, beaucoup d’entre eux se sentent appartenir à une minorité, ce qui ne les empêche pas de se sentir Français. C’est ça aussi dont on ne se rend pas toujours bien compte. Ça n’est pas jouer une appartenance contre l’autre. La masse de ces jeunes qui se mobilisent ont la même aspiration que ceux de la Marche pour l’égalité, même si une minorité, c’est vrai, ne pense pas ainsi. J’ai beaucoup aimé ce contact avec ces jeunes ; cela m’a redonné du courage car je sens comme un grave échec le fait de ne pas être parvenue à transmettre l’expérience de ma génération. On ne peut pas transmettre si l’on n’a pas une organisation permanente qui soutient cette transmission.
Y.G. : Les romans c’est une forme de transmission…
D.M. : Oui ! Cela étant, je n’ai pas du tout écrit ce roman en pensant à aujourd’hui. J’ai deux ans et demi ou trois ans de boulot derrière moi, c’est tombé comme ça. Mais c’est sûr que la situation actuelle nécessite une véritable réflexion de fond, sinon on est très très mal partis !


















