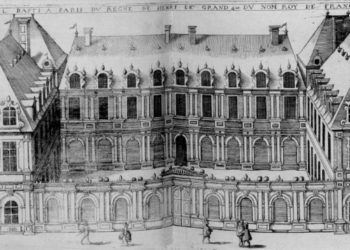Par Nathalie Heinich, sociologue, directrice de recherche au CNRS (EHESS)
(Article paru dans Le DDV n°681, décembre 2020)
Il y a une génération, la plupart des féministes ainsi que des antiracistes étaient, en France, universalistes : à travers la dénonciation des inégalités dues au sexe ou à la couleur de peau, ils visaient la suspension des différences là où elles n’ont pas à être prise en compte, au profit de l’affirmation de ce qui nous unit. Les choses ont bien changé pour la génération actuelle des jeunes militants, rebaptisés « activistes » par un anglicisme qui trahit l’origine de ces mouvements, importés des campus nord-américains et de leur culture communautariste : ils privilégient – sans en avoir forcément conscience tant cela semble aller de soi pour eux – le différentialisme, consistant à affirmer les différences (de sexe, de couleur de peau, ou encore d’orientation sexuelle) afin de dénoncer les discriminations.
Le féminisme décolonial
Un nouveau courant en est emblématique : le « féminisme décolonial », qui met en avant l’ « intersectionnalité », autrement dit le statut doublement discriminé des femmes de couleur. Or ce nouveau concept est la conséquence directe du différentialisme, puisque dès lors que les individus sont appréhendés d’emblée en tant qu’appartenant à un collectif assigné (de sexe, de « race », d’origine sociale, de religion etc.), il faut trouver des solutions pour rendre compte de l’évidente pluralité des identités : si l’on s’identifie entièrement à la communauté des femmes, comment s’identifier tout aussi entièrement à la communauté des gens de couleur – et réciproquement ? La seule solution est de créer une nouvelle identité, croisant les deux précédentes : d’où l’ « intersectionnalité », fer de lance du « féminisme décolonial ».
Or ce qui demeure implicite dans cette logique, c’est qu’il irait de soi d’enfermer une fois pour toutes les individus dans des catégories identitaires, de les « essentialiser » donc. Plutôt que de s’intéresser aux variations contextuelles des processus d’auto-perception, de présentation de soi et de désignation par autrui, grâce auxquels chacun se déplace selon les circonstances entre les différentes facettes de son identité, les adeptes de ce nouveau militantisme préfèrent s’appuyer sur l’essentialisation caricaturale des identités, auxquelles on prétend réduire les individus, en tous moments et en tous lieux – ce qu’on peut appeler l’« identitarisme ».
D’où une première contradiction propre à ce mouvement : pour mieux se débarrasser du « naturalisme » qui empêche la vieille garde de comprendre que le « sexe » n’est que du « genre » et que la « race » n’est que de la « racisation » (l’un et l’autre « socialement construits », bien sûr, selon le mantra en forme de slogan qui rappelle le « tout est politique » des années post-68), cette assignation identitaire enferme les individus « racisés » dans cette seule catégorie, exactement comme le font les racistes, puisque les néologismes « racisé », « racisation », « blanchité » réduisent le statut et l’expérience des individus à la seule couleur de peau : un enfermement bien plus efficace que toutes les croyances naïves dans la « naturalité » des conditions, auxquelles d’ailleurs plus grand-monde, probablement, n’adhère.
Une deuxième contradiction consiste à faire cohabiter un discours qui prétend déconstruire la différence des sexes en la dénaturalisant (« théorie du genre ») tout en s’efforçant de réduire les individus à leur identité sexuée (parité obligée en toutes circonstances, écriture inclusive…). Il en va de même avec la race : il faudrait à la fois éliminer cette notion en la dénaturalisant, et ne cesser de la ramener sur le devant de la scène en y assignant tout un chacun. Or ce qui est une contradiction sur le plan logique devient, sur le plan politique, un dispositif pervers, selon lequel les adversaires ne peuvent qu’avoir tort : si vous refusez l’effacement des différences comme solution aux discriminations, vous serez accusé de vouloir « naturaliser », donc pérenniser, ce qu’il faudrait éradiquer ; et si vous refusez la réduction obligatoire des êtres à leur identité sexuée ou raciale quels que soient les contextes, vous serez accusé d’aveuglement face aux discriminations. Pile je gagne, face tu perds…
Une troisième contradiction enfin est d’ordre directement politique : quoique s’affichant comme résolument progressiste, le féminisme décolonial, mixte de néo-féminisme radical et d’antiracisme aux relents racistes ne fait que dégoûter de la gauche une grande partie de son électorat traditionnel – ce qu’ont déjà noté des démocrates américains, tel Mark Lilla. Causes emblématiques de la gauche, l’antiracisme et le féminisme vont-ils en devenir les fossoyeurs ?
Victimisation collective
On peut lutter contre les discriminations sans pour autant pratiquer, à l’imitation de ce nouveau militantisme, l’instrumentalisation de la culpabilité comme moteur de toute position politique. Chez les néo-féministes « décoloniales », l’enfermement dans le statut de victime crée une identité collective ; de même que, à l’inverse, le statut de « mâle blanc dominant » – chargé de toutes les fautes, tels les chrétiens dévorés par le péché originel – crée à leurs yeux une identité collective de coupable. Dans cette focalisation obsessionnelle sur le couple dominant/dominé, il ne s’agit pas tant d’abolir la domination, selon le vieux schéma révolutionnaire, que de l’inverser : vite, que les femmes « racisées » occupent enfin les positions de leurs ennemis ! Remplaçons donc, dans les universités, les enseignants par des enseignantes et les blancs par des personnes de couleur. Et si celles-ci ne doivent leur promotion qu’à leur sexe ou à leur couleur de peau, mais pas à leur compétence ? Qu’importe ! Les coupables doivent devenir des victimes.
Enfin, l’on peut lutter contre les discriminations sans pratiquer pour autant le radicalisme de ces nouveaux militants, qui tend à substituer à l’argumentation raisonnée, soucieuse du contexte et de la pluralité des points de vue, les excès de postures extrémistes – comme si la raison était forcément du côté des extrêmes. Ce radicalisme sidère, fascine, et finit par laisser sans voix : il fait le buzz, et le silence après lui.
Ainsi, lorsqu’on est antisexiste et antiraciste, peut-on accepter de voir nos causes ainsi détournées, et notre combat pris en otage par des extrémistes dont on partage, pour l’essentiel, les fins (lutter contre les discriminations) mais en aucun cas les moyens ? Pour ma part je persiste à penser qu’il est encore possible d’être féministe sans être différentialiste ni considérer tout homme comme un ennemi ; qu’il est encore possible d’être antiraciste sans pratiquer l’inversion raciste consistant à considérer les blancs comme des ennemis ; que l’intelligence commande de prendre en compte la pluralité des contextes plutôt que d’imposer à tout un chacun une identité unique ; que l’humanisme, autant que le réalisme, interdisent la réduction du monde à la domination comme unique catégorie de perception et d’analyse ; et que le progressisme n’implique pas forcément l’adhésion à un radicalisme différentialiste qui a vite fait de se débarrasser de ses opposants en les renvoyant à l’enfer des « néo-réactionnaires » ou de « la droite » – voire pire.
Bref, je refuse que le féminisme soit pris en otage par le différentialisme, et l’antiracisme par un communautarisme virant au racisme inversé. Et j’ai l’espoir que l’humanisme universaliste ne baisse pas la tête, en redevenant la visée commune au nom de laquelle nous pourrons continuer dignement le combat pour l’égalité des droits. Certes, pour qu’il devienne plus efficace qu’il ne l’a été jusqu’à présent, il faut impérativement l’adapter aux nouvelles réalités démographiques, sociales, axiologiques, qui n’étaient pas celles face auxquelles se sont développés les premiers mouvements antiracistes et féministes. Mais cela, c’est une tâche autrement plus complexe que ne l’est la profération rituelle de slogans, ressassés comme des litanies dans les amphis par les plus bornés des étudiants et les plus démagogues des enseignants.
Article publié dans Le DDV n°681, décembre 2020.