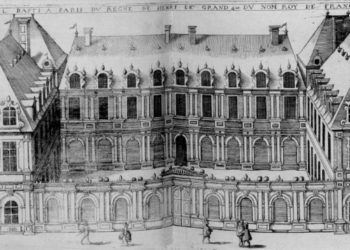Alain David, philosophe
Comment nos larmes n’iraient-elles pas d’un côté et de l’autre, l’effroi du 7 octobre, et aujourd’hui cette population de Gaza, plongée dans la détresse, otage depuis vingt ans d’une organisation criminelle ? D’une cause à l’autre, d’une légitimité à l’autre, chacune se contestant mutuellement dès que l’on voudrait poser des mots sur les faits. Et néanmoins – c’est ce que je voudrais tenter de faire valoir – chaque cause ne renvoie-t-elle pas, avant les mots, à une vérité (pour autant qu’on soit fondé encore à parler de vérité) qui vaut pour l’une et l’autre, à la vérité des larmes ?
La vérité des larmes !
Je lis, dans L’Humanisme de l’autre homme (1972) d’Emmanuel Levinas, ces lignes :
« Faiblesse sans lâcheté comme l’incalescence d’une pitié. Décharge de l’être qui se déprend. Les larmes c’est peut-être cela. Défaillance de l’être tombant en humanité qui n’a pas été digne de retenir l’attention des philosophes. Mais la violence qui ne serait pas ce sanglot réprimé ou qui l’aurait étranglé pour toujours, n’est même pas de la race de Caïn ; elle est fille de Hitler ou sa fille adoptive. »
Les larmes, donc, telles les indices d’une vérité plus profonde de l’humain, allant le quérir plus loin que ne le fait même l’histoire, plus loin que n’importe quel contexte. Les larmes, « comme l’incalescence d’une pitié » : déroutante et magnifique formule, l’exotisme du latin surimposant au français son étrange sonorité et suggérant, selon le sens du terme incalescere, devenir chaud, l’idée d’une sensibilité inédite, tout entière constituée de la brûlure de la souffrance de l’autre : comme si ce paroxysme surgi au plus profond de moi était le critère par excellence de l’humain. Et, à l’inverse, comme si être privé de cette faculté des larmes, c’était non seulement avoir les yeux et le cœur secs, mais être devenu Hitler – pire en cela que Caïn, figure emblématique du meurtrier – Caïn demeuré cependant humain, trop humain, jusque, pour Victor Hugo, au fond du tombeau où, dans le premier tableau de La Légende des siècles, il se montre accessible au remords. Hitler, au contraire, personnage récurrent, qui ne cesse de nous hanter, s’inscrivant comme une impossibilité toujours à pressentir et à redouter au fond de chacun de nous. On ne naît pas Hitler, on le devient.
« Hitler », récurrent, éternellement présent, sans limites. Au contraire, un homme a des limites. « Un homme », disait Camus, « ça s’empêche ». Et la limite par excellence, celle qui limite le moi dans son impérialisme naturel (son conatus, disait Spinoza, sa tendance naturelle à persévérer dans son être), c’est l’autre en moi, la singulière vérité des larmes. « Hitler » n’a pas de telles larmes. Il est investi de cette absence de limites que les juristes ont caractérisée au sortir de la guerre par les expressions de crime contre l’humanité et de génocide.
Le moment où l’humanité s’est perdue
C’est cela qui fut en cause le 7 octobre. Terrifiant inventaire d’atrocités, les vieux et les bébés, les femmes éventrées de qui on arrache, vivantes, le fœtus… Interminable et indicible énumération. Des images ont circulé, livrées à une mémoire médiatique trop courte (comme s’il était possible d’y inscrire l’Immémorial). Avec au bout, la question, désespérante : comment cela a-t-il été possible ? Comment ? Il n’est pas de réponse. L’expression « sans voix » qui inspire une belle tribune d’un philosophe franco-israélien, Raphaël Zagury-Orly – mais elle n’est également qu’une voix parmi toutes les autres – donne la teneur de ce silence bruissant et toutefois (comme pour ces personnages gesticulants que l’on contemplerait derrière une vitre) silencieux, à la mesure des larmes qu’il recouvre. Ce qu’il faut peut-être toutefois entendre de ce silence, ce qui me semble à entendre, c’est que par-delà la frénésie des foules, le sadisme des individus, les sentiments de haine, le fanatisme – tout ce qui pourrait, qui pourra donner matière aux spécialistes de tout genre qui mettront à jour des séquences causales et désigneront les erreurs ou les fautes des uns et des autres, il y va d’autre chose, du sans limite qui fait que l’autre n’aura pas été une limite, le moment où l’humanité s’est perdue : Hitler en nous, là où pleurer ne fait plus sens.
La tragédie
Ceci encore : l’une des situations (voire la situation ?) où l’humanité recueille le phénomène extraordinaire des larmes, est celle de sa rencontre avec le tragique, ce moment privilégié où côtoyant l’illimité elle le reconnaît comme tel, l’affronte, et le surmonte. Le grand poète allemand Hölderlin, méditant sur l’une des premières tragédies de notre histoire, Œdipe Roi de Sophocle, propose (en une phrase que je tiendrais volontiers pour l’une des plus profondes et les plus impressionnantes de la tradition occidentale) ceci :
« La présentation du tragique repose principalement sur ceci que le monstrueux, comment le Dieu-et-l’homme s’accouple, et comment, toute limite abolie, la puissance panique de la nature et le tréfonds de l’homme deviennent Un dans la fureur, se conçoit par ceci que le devenir-un illimité se purifie par une séparation illimitée. »
Phrase difficile, que je me risquerai cependant à tenter de commenter pour exprimer quelque chose de ce que nous traversons. « Toute limite abolie » – dans le langage que j’ai proposé « notre devenir Hitler », mais aussi le fait que l’illimité que représenterait l’égoïsme du quant à soi, « se purifie » « par une séparation illimitée » : j’entends surmonterait le pour soi par l’exposition à ce qui en moi surgit, en tant qu’infiniment séparé de moi, l’Autre en moi. Cela même se nomme, précise Hölderlin dans sa langue difficile, « Dieu-et-l’homme ». Tel serait le miracle de la tragédie, le « monstrueux », ce couple sans essence, difforme, le Moi-et-l’Autre, dont Hölderlin pressent qu’il est le rapport à Dieu. Ce couple, élément de la tragédie, laquelle (avait expliqué Aristote) provoque la terreur et la pitié, un torrent de larmes où l’individu pleure, saisi de la découverte non des malheurs qui lui arrivent, mais de ce qui, devant lui sur la scène, se produit comme n’arrivant pas, juste une histoire, accédant ainsi, en même temps qu’à sa capacité de pleurer, à son humanité [Hölderlin triche ici, peut-être : prétendant expliquer une tragédie grecque, il fait, me semble-t-il autre chose. Car « la Grèce » c’est l’appel à l’harmonie. Ce qu’Hölderlin au contraire exhibe, c’est l’infini rapport à une altérité posant une limite au cœur même de l’illimité, la leçon même de la Bible hébraïque, et ainsi au cœur du texte le plus grec la marque ou la résonance juive de l’humanité : l’humanité rendue à son judaïsme.].
Une capacité sans discrimination
Que s’est-il passé, que vivons-nous ? Dans le tourbillon qui nous enveloppe nous voyons, ébahis, des États, des ONG, des médias, protester au nom de la souffrance palestinienne, mais ignorer les autres victimes, les morts suppliciés du 7 octobre, mais aussi les otages, mais encore toutes les autres victimes, partout où l’ennemi juif privilégié n’est pas impliqué. Des foules immenses déferlent, au nom de l’islam, sans regard cependant pour la souffrance musulmane, en Bosnie, en Tchétchénie, au Xinjiang, en Birmanie, où Israël n’est pas en cause… Comment nommer cela ? L’antisémitisme ? Sûrement. Mais encore ?
Avant les mots, au-delà ou en-deçà des mots, c’est ce que j’ai voulu dire, il y a cette tentation, la grande tentation où l’humanité se perd, la tentation de l’illimité. Tentation qu’affronte, dit Hölderlin, la tragédie où « le devenir-un illimité se purifie par une séparation illimitée » : autrement dit en désignant dans son absence infinie l’autre en moi, en consentant aux larmes.
Capacité des larmes, antérieure à tout le reste, antérieure à tous les partis pris. Capacité sans discrimination, les larmes pour les victimes, pour les enfants, palestiniens, israéliens. Pour personne et pour tous.