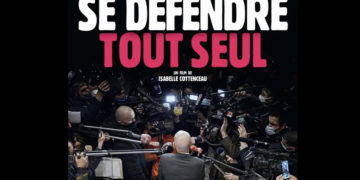Karan Mersch, professeur de philosophie
Les « anti-Charlie » voudraient faire passer le slogan « Je suis Charlie » pour une adhésion sans faille aux choix éditoriaux du journal, dans le but d’inspirer un rejet maximal à son endroit. Ainsi, certains de mes élèves de lycée pensent qu’en affirmant « être Charlie », un croyant se renie puisque le journal affiche clairement des positions athées. Natacha Polony donne de l’eau au moulin de cette rhétorique lorsqu’elle affirme : « Dix ans, aussi, à enfermer toute réflexion dans des slogans réducteurs et binaires « être » ou « ne pas être Charlie ». » La journaliste parle aussi d’ « embrigadement ». On trouve chez la députée Danièle Obono (La France insoumise) quelque chose de très proche, même si l’intention n’est pas la même : « Je refuse l’injonction manichéenne d’être Charlie ou de ne pas être Charlie1Danielle Obono sur RFI le 15 septembre 2020 à 14’18’’.. » Pour ces deux personnes, se dire « Charlie »… c’est déjà trop en dire. Il est toutefois à souligner que ce sont elles qui font dire à la formule bien plus que sa signification première. En classe, les jeunes comprennent aisément le parallèle suivant : de même que John Fitzgerald Kennedy, en visite à Berlin Ouest, le 26 juin 1963, ne sollicitait pas dans son célèbre discours l’asile politique en déclarant « Ich bin ein Berliner », dire « Je suis Charlie » n’oblige pas à apprécier tout ce que Charlie publie. En revanche, il y a un enjeu majeur dans le fait de comprendre que cet attentat islamiste a visé en plein cœur la liberté d’expression en punissant de mort un prétendu délit de blasphème.
Se dire Charlie, c’est aussi dire que leur courage nous engage.
Brouillages rhétoriques
On rencontre souvent chez les élèves une conception étonnamment naïve de la liberté d’expression. Il s’agit d’affirmer que chacun devrait pouvoir dire ce qu’il pense, sans aucune contrainte. Cela réduit le « Je suis Charlie » à un truisme, la formule signifiant que des journalistes, même « racistes », ne devraient pas être tués. Cette naïveté est encouragée par les intellectuels hostiles à Charlie avec une certaine perversité. L’assassinat est condamné mais la thèse mensongère selon laquelle l’assassin aurait agi en raison de l’ « islamophobie » des victimes est validée. Cette position relève en outre d’une conception absolue de la liberté d’expression. Toute restriction est considérée comme liberticide, y compris celle qui sanctionne l’incitation à la haine. À définir de la sorte la liberté d’expression, il devient simple de dénoncer une apparente contradiction entre le fait de se dire « Charlie » et le fait se réjouir des déboires judiciaires de Dieudonné M’Bala M’Bala ou de certains youtubeurs algériens. Après avoir dressé un tableau dévitalisé de ce que devrait être à leurs yeux le « Je suis Charlie », les « anti-Charlie » n’ont plus qu’à rejeter la formule au nom d’une prétendue incohérence.
Dans Franc-Tireur, Benjamin Sire remarque à ce propos que la députée Obono « n’a jamais épousé le slogan « Je suis Charlie » [et qu’] elle l’a même refusé », « alors qu’elle l’accorde à Dieudonné, qu’elle qualifie certes de « raciste et [d’] antisémite », mais dont elle a pris la défense… en regrettant que les « Charlie » se soient « tus quand l’État s’est attaqué » à lui ». Sur les réseaux sociaux, des comptes racistes suivent le même fil pour se dédouaner. Ils interrogent ironiquement : « Alors, on n’est plus « Charlie » ?
C’est encore ce raisonnement biaisé que suit le géopolitologue Pascal Boniface dans son podcast, lorsqu’il résume avec gourmandise ce que son invité Daniel Schneidermann appelle le « Charlisme » : « On est passé de la défense de la liberté à la création d’un nouveau blasphème : on n’a pas le droit d’avoir une vision critique de Charlie2Émission de Pascal Boniface « Entretiens géopo » avec Daniel Schneidermann : « Être ou ne pas être… Charlie », le 22 janvier 2025. » Quand on sait ce que l’accusation de blasphème a coûté à Charlie Hebdo, on se demande ce qui peut légitimer un tel parallèle. S’attaquer à Charlie ne demande aucun courage. Dans une inversion accusatoire, les survivants et les soutiens sont crédités de la violence de ceux qui ont assassiné leurs amis. Pour ne pas être accusés de créer un nouveau délit de « blasphème », ceux qui se disent « Charlie » ne devraient pas répondre lorsque sont répandus à leur endroit les mensonges qui ont coûté la vie à l’équipe de l’hebdomadaire le 7 janvier 2015.
Liberté et responsabilité
Tous ces contempteurs du « Je suis Charlie » agitent ici une conception plus forte encore que le « free speech » américain (même le premier amendement a été limité par la cour suprême). Ils détournent volontiers une citation apocryphe de Voltaire – « Je ne suis pas d’accord avec vous, mais je me battrai jusqu’à la mort pour que vous puissiez le dire » –, soucieux qu’ils sont de démontrer leur attachement sans faille au pluralisme des opinions. Une confusion volontaire est toutefois entretenue avec le principe de pouvoir exprimer n’importe quelles idées, même les plus mortifères.
S’attaquer à Charlie ne demande aucun courage. Dans une inversion accusatoire, les survivants et les soutiens sont crédités de la violence de ceux qui ont assassiné leurs amis.
Se dire « Charlie », c’est pourtant s’affirmer en faveur la liberté d’expression telle qu’elle est protégée et encadré par la loi républicaine. Il n’a jamais été question de se défaire de toute responsabilité au prétexte de l’humour. Il n’y a donc aucune contradiction à se dire « Charlie », et à trouver problématique que Guillaume Meurice définisse le chef du gouvernement israélien par sa circoncision et en le nazifiant. Certains soutiennent le courage d’un journal à s’opposer aux diktats des terroristes quand d’autres se font les défenseurs d’un droit à salir, sinon à haïr. Tout le monde n’a pas les mêmes priorités, mais le combat des « anti-Charlie » manque cruellement de panache.
Travaux pratiques
Même lorsqu’il ne s’agit pas de religion, la forme dans laquelle Charlie Hebdo inscrit le dessin de presse est insupportable pour les islamistes comme pour les petits gardes rouges, car elle muscle les capacités critiques des citoyens. Aborder les dessins de Charlie Hebdo en classe est une expérience particulièrement intéressante. Lors d’un cours de philosophie sur la liberté d’expression, un élève a affirmé que cette dernière devrait être bien plus sévèrement limitée. Il a illustré son propos en faisant référence à un dessin de l’hebdomadaire satirique lequel, en plein procès des viols de Mazan, enflamma les réseaux sociaux : « Matignon, les consultations continuent3Dessin de Félix pour Charlie Hebdo le 4 septembre 2024.. » Pour cet élève, le dessin se moquait de façon honteuse de Gisèle Pélicot. Le dessin a été projeté au tableau. Une bonne partie de la classe s’est jointe à son indignation. Passé un moment où les élèves ont pu exprimer leur émotion, nous avons pu commencer à réfléchir ensemble : que signifie le bonnet Phrygien porté par le personnage féminin ? Est-il insultant de représenter la France dans cette posture ? Est-il honteux d’être une victime ? Qui était mis en cause dans ce dessin, la femme qui subissait sans pouvoir rien faire ou l’homme qui organisait et filmait ? En définitive, les élèves ont compris que loin de se moquer de Gisèle Pélicot, ce dessin était une critique des plus dures à l’encontre d’Emmanuel Macron. Je les ai « rassurés » : ils avaient le droit d’aimer ou de ne pas aimer ce dessin, de le trouver trop dur ou non envers le Président de la République. Cette représentation d’une scène de viol pouvait légitimement les mettre mal à l’aise mais j’ai insisté sur le fait qu’il était important de ne pas se méprendre sur son propos. Tous ont finalement compris qu’il ne s’agissait pas de se moquer de Gisèle Pélicot.
Comme des personnes qui ne s’ouvrent à la sensibilité esthétique qu’une fois dans les musées ou les salles de concert, nous avons tendance à réfléchir de manière compartimentée. Charlie ouvre les portes et propose un exercice dans un espace contre-intuitif. Il est comme une expérience de street art ou de land art.
L’exercice a été répété avec le dessin sur la mort du petit Aylan, puis avec le dessin « Mahomet, une étoile est née », réalisé par Coco en 2012 – et qui faisait partie des dessins que Samuel Paty avait montré à ses élèves –, et les mêmes conclusions ont pu être tirées. Les élèves ont vu le dessin « Ils ont les armes, on a le champagne ! » et ils ont compris que représenter Charlie sous la forme d’une personne criblée de balles, ne devait pas rappeler des souvenirs agréables aux rescapés de l’équipe mais qu’il ne s’agissait pas de rire à leur détriment.
La pensée critique en exercice
Ainsi, « l’esprit Charlie » en plus de l’engagement laïque, qui doit laisser la possibilité « d’emmerder Dieu »4Célèbre formule de l’avocat Richard Malka., a une autre vertu. Il réside dans l’exercice de la raison en terrain hostile, lorsque l’émotion envahit le débat public. Comme des personnes qui ne s’ouvrent à la sensibilité esthétique qu’une fois dans les musées ou les salles de concert, nous avons tendance à réfléchir de manière compartimentée. Charlie ouvre les portes et propose un exercice dans un espace contre-intuitif. Il est comme une expérience de street art ou de land art. Pour donner un sens qui ne soit pas abscons à ses dessins, nous devons dépasser les passions qu’ils soulèvent afin de nous orienter dans la tempête des passions. L’acquisition de ce contrôle, de cette volonté de ne pas abdiquer la raison lorsqu’elle n’est plus en terrain favorable est déterminante pour que les citoyens puissent continuer à produire des interprétations solides.
Car plus que jamais, les passions pèsent sur l’entendement. Ce dérèglement de l’interprétation fait le bonheur des populismes en corrodant le lien organique qui unit vérité et démocratie. Par-delà le fait de les apprécier ou non, les dessins de Charlie sont ainsi un exercice salutaire pour apprendre à jauger la réalité, résister à la submersion de l’émotion et à ceux qui l’instrumentalisent. Ce qui fait une raison supplémentaire de se dire « Charlie ».