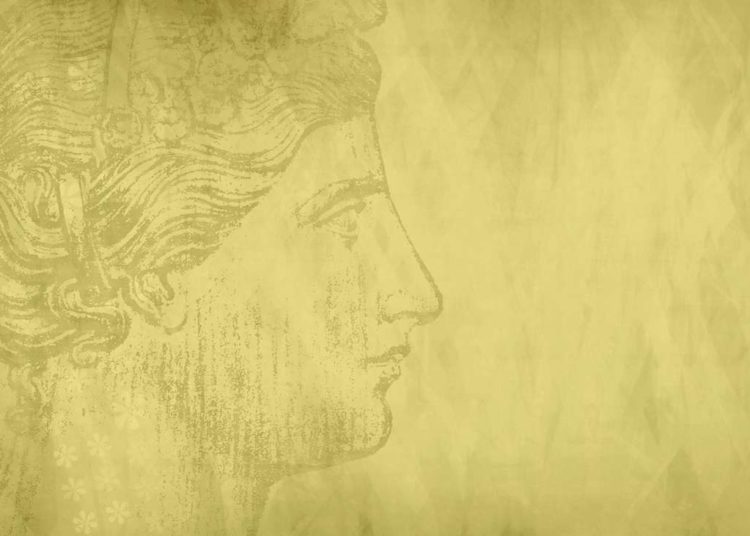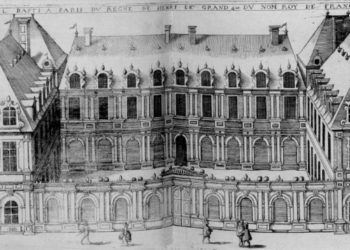Par Pierre-André Taguieff, philosophe, politiste et historien des idées, directeur de recherche au CNRS
(Article paru dans Le DDV n°683, juin 2021)
La politisation des identités collectives s’est opérée suivant plusieurs voies, à la faveur de la montée des ethnismes, des micronationalismes séparatistes et des ethno-nationalismes, de l’émergence du néo-racisme sous ses différentes formes, de la radicalité croissante du militantisme féministe et LGBTQIA+, de l’explosion des fondamentalismes qui politisent les identités religieuses, de la diffusion du multiculturalisme appelant à reconnaître des « citoyennetés différenciées ». Simultanément, l’évocation des identités mémorielles est devenue un phénomène de mode : la rivalité mimétique des revendications identitaires fondées sur les mémoires victimaires s’est banalisée dans l’espace politico-culturel, à tel point qu’on a justement déploré les « abus de la mémoire ».
Les promoteurs de la reconnaissance des identités de groupe, qu’elles soient culturelles (linguistiques, religieuses) ou ethniques, sexuelles ou de genre, nationales ou régionales, voire raciales, ne cessent de se heurter aux partisans d’une stricte neutralité axiologique de la sphère publique à l’égard des particularismes, des identités minoritaires et des « communautarismes ». Cette promotion des questions identitaires dans l’espace des débats et des controverses va de pair avec une crise de l’identité nationale et de l’identité européenne, et, plus profondément, avec une « crise de l’idée même d’identité ».
Choix identitaires et estime de soi
Les identités collectives se définissent avant tout comme des identités culturelles. L’anthropologue Louis Dumont défend le principe d’une approche culturaliste et comparative des identités collectives : « Chaque culture est à considérer en relation avec son environnement. Elle porte l’identité collective d’une population, trop souvent considérée en termes exclusivement politiques, et comme telle elle tend à persévérer dans son être, soit en dominant les autres soit en se défendant contre leur domination. » Culture et identité sont des interprétations du même phénomène. C’est là ce que reconnaissait en historien le maître d’œuvre des Lieux de mémoire, Pierre Nora, lorsqu’il écrivait au début des années 1990 : « Identité, mémoire, patrimoine : les trois mots clés de la conscience contemporaine, les trois faces du nouveau continent Culture. (…) Identité renvoie à une singularité qui se choisit, une spécificité qui s’assume, une permanence qui se reconnaît, une solidarité à soi-même qui s’éprouve. » En cela, elle incarne une valeur.
Être soi-même, pour un individu, c’est d’abord se reconnaître comme ayant une ou plusieurs origine(s), une ou plusieurs appartenance(s), une religion, une langue maternelle, un prénom et un patronyme, une ou plusieurs profession(s), etc. Il lui revient de choisir le trait distinctif le plus saillant pour se définir. Les choix identitaires s’avèrent inséparables de l’estime de soi, qu’il s’agisse de l’identité personnelle ou de l’identité des mouvements sociaux.
Dans les sociétés contemporaines où l’individualisme narcissique est saisi par le politiquement correct, la culture de l’authenticité tend à se réfugier dans la sphère privée. On suppose en conséquence que l’épanouissement personnel n’a nul besoin de prendre appui sur des origines ou des racines. Plus l’identité personnelle est valorisée, et plus les identités collectives sont suspectées, voire stigmatisées. Toutes sont soupçonnées ou accusées d’exprimer une vision essentialiste. Certaines plus que d’autres : il en va ainsi de l’identité nationale, qui, selon ses accusateurs, ne pourrait être définie sans exclure ni discriminer certaines catégories de la population considérée. L’opinion est largement partagée dans les milieux des sciences sociales, ralliés à une vision constructiviste et à la pratique systématique de la déconstruction.
Dans le monde des nouvelles élites, déterritorialisées ou mondialisées, l’estime de soi ne passe plus par le sentiment d’une origine ethnique ou nationale commune, ni par un mode d’appartenance, ni même par la fidélité à un héritage culturel. Et la discussion des questions d’identité se réduit à l’affirmation, inlassablement reprise, que les identités collectives sont « construites » (ce que nul ne nie), ainsi qu’à l’incitation à les « déconstruire » (en raison de leurs effets négatifs présumés).
Le droit d’être soi-même
On attribue souvent aux conservateurs la volonté de conserver les identités collectives instituées, reconnues comme telles, vécues comme des communautés de représentations, de croyances et d’émotions, et incarnées par des traditions. Or, au nom des Lumières et de l’idée d’émancipation, tout attachement à une identité de groupe tend à être dénoncé comme une forme de « régression identitaire » fondée sur une « illusion identitaire », oscillant elle-même entre une « rêverie identitaire » et une « obsession identitaire ». L’arrachement aux déterminismes historico-culturels a longtemps joué le rôle d’un projet normatif réputé « moderne », illustrant le processus de « modernisation », supposé à la fois irréversible et bénéfique.
Depuis les années 1990, l’identité est souvent mise en accusation sur la base d’un argument principal : elle serait la source commune des mobilisations idéologiques rivales qui ont ensanglanté le XXe siècle, ce siècle des « slogans qui font marcher les masses » comme le rappelle l’historien de la littérature Marc Fumaroli, celui des « mots abstraits » véhiculant des « idées courtes, mais mobilisatrices », résumées par des « ismes » : nationalisme, racisme, national-socialisme, fascisme, communisme, intégrisme. Or, ces « générateurs de langue de bois » s’avèrent avoir pour « substrat, en dernière analyse, une idée de mort : l’identité », affirme Fumaroli.
Cette condamnation morale et politique de l’identité se rencontre surtout chez les adeptes d’un cosmopolitisme libéral très répandu chez les nouvelles élites de la mondialisation économique et culturelle, qui ont tendance à diaboliser toutes les formes de nationalisme. Il y a là un amalgame polémique : l’attachement à une identité nationale n’implique ni le chauvinisme, ni la xénophobie ou le racisme. Mais il est vrai que les démagogues et les despotes exploitent les thèmes identitaires à des fins douteuses. C’est là cependant un tout autre problème.
Le droit d’être soi-même, donc de préserver les diverses composantes historiques et culturelles de son identité, fait partie des libertés fondamentales. Ce qui impose non pas un retour impossible au passé tel qu’il fut, mais un retour au concret, c’est-à-dire aux communautés existantes, politiques ou non, sources d’identité. Tous les humains sont dotés d’une égale dignité, mais chaque individu a aussi droit à une identité, celle qu’il juge centrale, ou à un complexe singulier d’appartenances identitaires, enveloppant des héritages culturels ou des traditions – qu’elles soient religieuses ou non. Ce qui revient à une réhabilitation de la tradition, dans la voie tracée par l’herméneutique philosophique de Hans-Georg Gadamer et de Paul Ricœur, ou encore par Claude Lévi-Strauss appelant à ne pas voir du racisme dans l’attachement ou la fidélité à un ensemble de valeurs et à un style de vie.
Une impossible déconstruction sans fin
On peut supposer, à la suite du philosophe Julien Freund, que « la perte du sentiment d’identité collective est génératrice et amplificatrice de détresse et d’angoisse ». Cette perte se traduit par ce qu’on appelle, depuis les travaux d’Erik Erikson, une « crise d’identité », un brouillage du sens affectant à la fois l’identité du citoyen et l’appartenance à une nation, mais aussi l’identité personnelle.
La tendance politiquement correcte ou « wokiste » à criminaliser rétrospectivement le passé, en particulier le passé national, favorise la centration sur le présent ou l’actuel, fantasmé comme le dernier moment, le seul porteur de « progrès » ou d’avenir meilleur, sur le mode social-démocrate ou sur le mode néolibéral, à condition qu’il soit totalement « purifié » des héritages du passé maudit (esclavage, colonialisme, nationalisme xénophobe, etc.). Or, la rétro-satanisation est devenue un exercice aussi banal que l’indignation morale sélective. Mais la rupture avec le passé est pathogène : elle produit du désarroi et de l’anxiété. Elle fait sortir la France contemporaine de l’Histoire en faisant du peuple français un peuple sans histoire ou à la mémoire collective intrinsèquement honteuse.
C’est précisément parce que la « continuité dans le temps » est « le bien le plus précieux de l’homme dans l’ordre temporel » qu’« aujourd’hui, la conservation du peu qui reste devrait devenir presque une idée fixe », écrivait Simone Weil dans L’Enracinement. Conserver, c’est prendre en charge un héritage, se soucier d’une continuité entre les générations. C’est donc transmettre. Or, l’une des principales caractéristiques d’une identité collective est qu’elle donne lieu à une transmission intergénérationnelle.
Nul ne peut vivre dans la rupture permanente et la déconstruction sans fin. Ni dans l’état d’urgence et d’incertitude d’un sujet contraint de choisir toujours de nouvelles identités, condamné à se réinventer sans cesse pour sacrifier au double impératif néolibéral de mobilité et d’innovation. Les humains ne se contentent pas de posséder une identité humaine. Ils ne se réduisent pas à leur appartenance à une espèce zoologique, l’espèce humaine. Ils sont des animaux politiques, et le genre humain n’est pas un ordre politique.