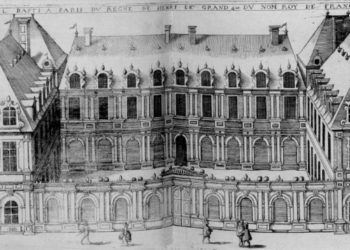Par Laurent Dubreuil, professeur de littérature comparée, de littérature française et de science cognitive à l’Université Cornell (États-Unis)
(Article paru dans Le DDV n°683, juin 2021)
Aux États-Unis, le terme de « politique d’identité » (identity politics) naît dans les années 1970 et semble imprimé pour la première fois dans un tract émanant du Combahee River Collective, un groupe de femmes noires lesbiennes d’extrême gauche émanant de la région de Boston. On y trouve l’article de foi suivant : « Nous croyons que la politique la plus profonde et potentiellement la plus radicale provient directement de notre propre identité, et non pas de la tâche consistant à mettre fin à l’oppression de quelqu’un d’autre. »
La croyance dans l’existence d’identités séparées, mais éventuellement croisées (« intersectionnelles » dans le jargon du jour), est ici énoncée et permet aux signataires du tract de se présenter « en tant que féministes noires et lesbiennes ». L’idée n’est pas seulement de se situer mais de partir de ladite situation muée en identité et d’en déduire une politique. L’enjeu n’est pas seulement de « faire reconnaître » telle ou telle identité mais bien de reconfigurer la politique même par la préséance d’un en-tant-qu’isme. Étant ceci, je pense et fais cela.
Il est toutefois à noter que ce manifeste maintient une ultérieure perspective d’émancipation générale (« que les femmes noires soient libres signifierait forcément que tous les autres le sont, puisque notre liberté nécessiterait la destruction de tous les systèmes d’oppression »). Il met également en garde contre le risque explicite de « fractionalisation », soit le repli de chaque identité sur elle-même, et il critique aussitôt certaines « femmes blanches qui sont séparatistes ». Ainsi, le texte fondateur de la politique d’identité, quoi que l’on en puisse penser, saisit nettement le risque de séparatisme que peut produire l’affirmation identitaire.
Un piège antidémocratique et antirévolutionnaire
Qu’en est-il aujourd’hui ? Comme je l’ai montré dans La dictature des identités[1], nous assistons actuellement, aux États-Unis, à une troisième vague d’identity politics (la deuxième se situant dans les années 1980-90). Elle se rattache historiquement aux propositions d’origine, mais s’en est violemment éloignée en plusieurs aspects cruciaux. D’abord, l’idée d’émancipation est largement reléguée, voire oubliée. Désormais, l’accent porte sur : la mise au ban du camp adverse ; les réparations symboliques et financières pour les torts passés ; une redistribution des prébendes ; le ressassement de la blessure comme trait définitoire des identités (d’où l’impasse logique : ne plus souffrir, c’est-à-dire ne plus être opprimé, serait renoncer à son identité, voire la trahir, ce qui est impossible pour l’identitarisme intégral) ; le séparatisme pratique, via la construction de safe spaces et le droit de ne pas voir, lire, rencontrer des œuvres ou des paroles possiblement offensantes.
La nouvelle politique d’identité est un piège, antidémocratique et antirévolutionnaire. Antidémocratique, car il n’est bientôt plus d’espace commun et que le débat se résume aux soliloques, à l’invective, aux procès, aux appels à la censure et aux demandes d’excuses publiques, selon les mœurs de la cancel culture. Antirévolutionnaire, car le centrage sur l’identité navrée tout autant que le cynisme intéressé des groupes organisés sont foncièrement conservateurs et ne modifient pas le cadre d’ensemble du pouvoir, mais seulement ses « meubles ».
Quel jeu de dupes, lorsque nous voyons des identitaires s’affirmer d’extrême gauche ! Il suffit de voir que le cœur du trumpisme était une politique d’identité blanche, reprenant tous les signes ordinaires de la nouvelle orthodoxie. Il suffit, surtout, de constater que la plupart des secteurs moteurs du capitalisme américain sont, dans leur structure de commandement, intégralement acquis à la politique d’identité. Rien de moins marxiste, donc, que cet accompagnement de ce qui fait désormais consensus dans les multinationales. Or ce capitalisme, sous sa forme communicationnelle présente, a sécrété une culture globalisée qui n’est plus américaine, qui, de plus en plus, constitue une dimension supplémentaire s’ajoutant aux réalités locales et parfois infusant dans le reste de la société. Un hashtag peut déboucher sur une proposition de loi. Ou bien, mon ancien camarade d’hypokhâgne Samuel Paty peut être brutalement assassiné, à la convergence entre les modes d’action de l’identitarisme 2.0 (dénonciation sur Internet d’une blessure catégorielle, appel à la punition du coupable désigné, le tout grâce à la caisse de résonance d’un réseau attentif par définition à toute expression de phobie, fût-elle fabriquée) et le terrorisme islamiste en quête de victimes « symboliques ».
Des musées poreux aux thèses identitaires
À l’instar des médias, de la tech et du pouvoir universitaire, aux États-Unis, les musées et le monde de l’art s’avèrent éminemment poreux aux percolations identitaires des années 2020. L’explication facile serait que les institutions muséales constituent le dernier bastion du pouvoir blanc. Voire. Il est en revanche certain que tous les musées américains, même les plus riches, dépendent directement des contributions financières de leurs trustees (des administrateurs issus d’organismes privés)et d’autres donateurs et que nombre de ces derniers sont partie prenante de la promotion identitaire dans leur secteur d’industrie et leur engagement partisan. La dénonciation « par la base » du racisme systémique peut prendre à l’occasion des aspects inconvenants pour les milliardaires qui soutiennent les musées, mais ces philanthropes sont, le plus souvent, pleinement d’accord, sur le fond, avec un programme qui consiste à soutenir l’atomisation du corps social en identités déterministes afin de ne jamais poser la question du bien-fondé d’un système économique.
Alors, tout est bon. Une pétition soutenue par des milliers de signataires et promue en une du New York Times demande la relégation d’une toile de Balthus (du Metropolitan Art Museum) car elle porte atteinte à l’identité d’une jeune fille. Pour une autre pétition, elle aussi largement relayée dans les médias, « il n’est pas acceptable qu’une personne blanche transmue la souffrance noire en profit et en amusement », et la toile de Dana Schutz montrant le jeune Emmett Till (lynché en 1955) doit donc être « détruite » ou retirée « du marché ». Les tableaux de Philip Guston caricaturant des membres du Ku Klux Klan ne peuvent plus être montrés par de grands musées américains dans l’immédiat car leur simple exposition est source de souffrance (alors que l’intention satirique à l’encontre du KKK est indéniable). L’accrochage d’œuvres, réalisées par des « personnes de couleur » en hommage à Breonna Taylor (tuée par des policiers en 2020), parce qu’il se fait dans des salles originellement dédiées à l’art hollandais, « est un acte de décolonisation », nous assure la commissaire de l’exposition au Musée de Louisville. Plusieurs musées (à Baltimore, à Syracuse, à Brooklyn) revendent certaines de leurs toiles peintes par « des hommes blancs » afin d’acheter des tableaux d’artistes « femmes » ou « de couleur ».
Écueil du kitsch et tentation totalitaire
On pourrait multiplier les exemples. Le problème, à chaque fois, n’est pas la dénonciation de préjugés racistes ou sexistes dans les musées ou le monde de l’art (il en reste beaucoup, qu’il est moralement juste de rejeter), mais l’annulation, au nom de la déesse Identité, de trois types d’écarts pourtant essentiels : entre la représentation et le représenté (le dessin d’un membre du Klan « fait mal ») ; entre le présent politique et la présence de l’œuvre (qui, grande, transcende toute époque, la sienne et la nôtre) ; entre la présentation de l’artiste (son inscription sociale et politique) et la fonction qu’on lui impose d’être désormais un simple représentant (d’une identité donnée).
En outre, s’il se trouve des cultures du même, il n’est pas d’art sans altération. Pas d’œuvre d’art sans devenir, sans métamorphose, sans transformation, sans modification du donné. La production picturale, architecturale ou sonore qui représente l’identique sous contrainte d’une authenticité présumée du fabriquant avec son objet (comme dans « l’art aryen », par exemple) relève du kitsch le plus sinistre ou du totalitarisme. Mais pas de l’art. A contrario, il devient impératif, si l’on tient à exprimer le suc despotique de l’identité politique, de lutter contre l’art au musée. Et c’est ce qui se passe, donc, dans un effet d’abolition générale qui, poursuivi, aboutira non pas à l’effacement ou la revalorisation de telle ou telle culture associée à un sous-groupe, mais, in fine, à l’oblitération systématique de toute idée même d’art.La Dictature des identités, par Laurent Dubreuil (Gallimard, collection Le Débat, 2019)
[1] La Dictature des identités, Paris, Gallimard (collection Le Débat) 2019.