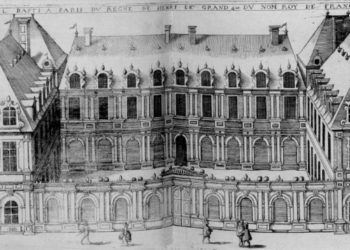Par Alain Lewkowicz, journaliste
(Article publié dans Le DDV n°681, décembre 2020)
Octobre 2005 devant l’université centrale des Minorités au nord-est de Pékin dans le district de Haidian. Je venais de terminer un entretien consacré aux musulmans de Chine avec le doyen de cette prestigieuse faculté. Un jeune homme m’aborde, s’inquiétant de savoir si j’étais perdu et si j’avais besoin d’aide. Il n’était pas Han, l’ethnie chinoise majoritaire qui représente plus de 90% de la population. Il avait 20 ans, s’appelait Ahmat, musulman turcophone. Il se présentait comme prince ouïghour du Turkestan oriental, province que les Chinois appellent le Xinjiang, littéralement « la nouvelle frontière », la Région autonome ouïghoure, située à l’extrême ouest de la Chine. Sa « Terre natale ». Un pays fantasmé, sublimé, tant ses souvenirs étaient lointains puisque ses parents s’étaient installés à Pékin lorsqu’il avait à peine cinq ans. Il n’y était jamais retourné mais il serait volontiers mon guide si je décidais de parcourir les près de 4 000 kilomètres qui nous séparaient de sa ville originelle, Kachgar, carrefour des anciennes routes de la soie et berceau de la culture ouïghoure. En attendant, la nuit tombait et il m’invitait à rompre le jeûne du ramadan à Xuanwu, du côté de la plus ancienne mosquée de la ville. Dans les effluves et les parfums de fondues d’agneau, de moutons ou de brochettes pimentées se bousculaient Huis, Ouïghours, Ouzbeks, Kazakhs et Mongols dans un espace qui se réduisait comme peau de chagrin
La fin d’un monde
Pékin faisait peau neuve en vue de l’organisation des JO de 2008. Des pans entiers de ce vieux quartier musulman disparaissaient, laissant place à des avenues surdimensionnées, bordées de buildings à l’image de ce que devait être la « Chine de demain ». Mais Ahmat était confiant. Il me montrait fièrement au fil de notre déambulation, là une mosquée, ici un salon de thé musulman, une librairie où l’on trouvait des corans « made in Pakistan », un supermarché halal « qui pourrait bien devenir une chaine connue dans le monde entier ». Nous nous attablions enfin dans une salle de restaurant bondée où, à ma grande surprise, une serveuse voilée en robe traditionnelle ouïghoure, me proposait une bière. « Ici c’est halal mais on vend de l’alcool pour faire des affaires avec les Hans », m’expliquait Ahmat qui ne pouvait toutefois s’empêcher de se méfier d’eux. « Ils n’aiment pas trop les gens différents. Ils ne croient en aucun dieu et veulent que nous fassions pareil. Ils pensent qu’avoir la foi, c’est stupide », me chuchotait-il.
Il me relatait l’histoire immémoriale des Ouïghours et du Turkestan oriental, territoire définitivement intégré à l’empire du Milieu à la fin du XIXe siècle mais qui avait connu l’indépendance, en 1933 pendant un an et de 1944 à 1949, année marquée par le début de la colonisation chinoise. Funeste époque puisque toute l’élite politique ouïghoure d’alors allait disparaître au-dessus de la Mongolie, dans le crash de l’avion qui devaient la mener à Pékin où Mao l’avait conviée. Un tragique accident ? Puis il me racontait la disparition de près de 15 000 intellectuels, artistes, professeurs, imams, de tout le gotha culturel et économique de son pays au cours de la Révolution culturelle et ne cessait de me parler de son rêve de voir renaître, un Turkestan oriental libre et indépendant dans lequel sa famille princière retrouverait sa splendeur d’antan. Candeur de jeunesse ? N’avait-il pas pris la mesure de ce qui se jouait et qui s’accentuait depuis les attentats du 11 septembre 2001 ? Le Xinjiang région frontalière du Kazakhstan, du Kirghizistan, du Tadjikistan, de l’Afghanistan et du Pakistan, devenait une zone à risques où Pékin mettait en pratique sa version de la politique de lutte contre le terrorisme international : répression, acculturation et déculturation, sinisation à marche forcée de cette province grande comme trois fois la France, et de ces 12 millions de Ouïghours.
Contrôle et répression
Après ce dîner, je n’ai plus jamais revu Ahmat. Son téléphone ne fonctionnait plus et sans son nom de famille, le rechercher à la fac était mission impossible. Tandis que le monde tombait dans une sino-béatitude, émerveillé par la promesse de marchés et de contrats juteux avec une Chine émergeante usine du monde, les quartiers ouïghours des grandes métropoles étaient folklorisés pour n’être plus que des caricatures et l’ombre d’eux-mêmes. 15 ans se sont écoulés tandis que les espoirs d’Ahmat ont sans doute fini par s’envoler. Combien sont-ils aujourd’hui, ces Ouïghours, à croupir dans des camps de « rééducation », « internement », « concentration » comme on les appelle ? En 2018, des images satellites identifient pas moins de 200 camps suffisamment grands pour y enfermer jusqu’à trois millions de personnes. Si la Chine a nié dans un premier temps leur existence, précisant avoir officiellement mis un terme à la rééducation par le travail en 2013, elle va finir par reconnaître cette mise au pas du Xinjiang. Car il faut « Strike hard » (« frapper fort ») comme disent les officiels, contre la menace islamiste. Et pour ça, l’administration Xi Jinping n’a pas lésiné sur les moyens depuis sa prise de fonction en 2013.
L’étau se resserre en 2016 lorsque s’installe sur le fauteuil de premier secrétaire du parti communiste de la province, le tristement célèbre Chen Quanguo, ancien militaire qui a exercé ses « talents » dans la région autonome du Tibet. « L’homme de fer » verrouille la province et met chaque Ouïghour sous surveillance. « Peu de temps après son arrivée, on a commencé à entendre parler d’analyses de sang et de tests ADN. Ma mère a été convoquée, mais elle refusé de s’y rendre. Ces tests étaient destinés à savoir qui il fallait envoyer dans les camps où l’on prélevait les organes. Beaucoup de gens arrêtés sont morts, vidés de leurs organes vitaux », raconte Mirqedir Mirzat, vice-président de l’Association des Ouïghours de France et depuis novembre 2019, vice-premier ministre du gouvernement du Turkestan oriental en exil.
Surveillance et interdits
Chen fait arrêter les intellectuels, les hommes d’affaires, les footballeurs, met sur écoute tous les téléphones portables scannés à chaque coin de rue et surveille la moindre parole suspecte qui circulerait sur les réseaux sociaux et les applications. Partout des caméras de surveillance à reconnaissance faciale épient les moindres gestes, le moindre signe qui pourrait justifier une privation de libertés arbitraire. Des 50 signes de radicalisation établis en 2013, on passe à 75. Une liste ubuesque qui prêterait à sourire, si elle ne provoquait pas l’internement massif d’une population prise en otage dans son « propre pays ». « Si vous n’êtes pas professeur et que vous avez beaucoup de livres, si vous avez plus qu’un couteau dans votre cuisine, si vous avez porté plainte contre un fonctionnaire, si vous refusez de fumer devant une personne âgée, si vous avez une barbe avant 50 ans, si vous avez voyagé dans un pays musulman, si vous utilisez WhatsApp ou VPN, si vous avez des images de mosquées dans votre téléphone… etc. vous finissez dans un camp », précise Muhammad, jeune étudiant ouïghour.

Son prénom fait d’ailleurs parti d’une liste de 32 prénoms désormais interdit par l’état civil. Les Aïcha, Zakaria, Talib, Wahab, Haji, Hussein ou encore Muhtehid sont bannis. Les enfants sont placés dans des camps d’endoctrinement, empêchés de parler leur langue, poussés à dénoncer leurs parents, formatés pour devenir de bons petits chinois. Sadir, originaire d’Urumqi, la capitale provinciale du Xinjiang, n’a que trois ans quand son père est exécuté pour le meurtre d’un chinois Han. Les autorités le confient à son oncle et à sa tante, deux ouïghours pur jus mais totalement inféodés à Pékin en tant que cadres influents au sein du gouvernement local. « Pendant 10 ans ils m’ont caché mon histoire, celle de mon père exécuté. J’ai toujours cru qu’ils étaient mes vrais parents. Alors quand j’ai appris la vérité j’ai commencé à lire les livres interdits, ceux qu’on ne trouvait pas à l’école, ceux qui nous enseignaient autre chose que l’histoire de la Chine et des Hans. Des livres qui parlaient du Turkestan oriental, de l’histoire de notre peuple. C’est ainsi que j’ai pris conscience des inégalités criantes qu’il y avait entre les Chinois de plus en plus nombreux et les Ouïghours », raconte Sadir âgé aujourd’hui de 29 ans.
Esclaves des temps modernes
Car pour changer la donne, Pékin a toujours misé sur un déséquilibre démographique savamment orchestré avec une politique favorisant une immigration massive de Chinois Hans dans cette province reculée et aride. À la clef, des emplois bien rémunérés, des terres, des maisons et la possibilité d’échapper à la politique de l’enfant unique imposée aux Hans de 1979 à 2015. Résultat : en 1949, les Hans ne représentaient que 4% de la population. Les Ouïghours, 80%. Aujourd’hui, les Hans représentent 45% de la population, comme les Ouïghours. « Après les émeutes interethniques de 2009, mon professeur d’histoire, qui était une personnalité publique très connue et très appréciée s’est mis à nous raconter autre chose que l’histoire chinoise et celle des Hans. La dernière fois que je l’ai vu, il nettoyait les toilettes de l’établissement dans lequel il avait enseigné, ce qui lui était désormais totalement interdit. Moi, je suis devenu un véritable indépendantiste », confie Sadir. En 2017, l’organisation Human Rights Watch parlait du Xinjiang comme l’endroit le plus surveillé au monde tandis que la Chine admettait l’ouverture de 17 « orphelinats » supplémentaires à Kachgar, la deuxième ville de la région et que les premiers témoignages faisaient état des conditions d’existences dans ce que Pékin appelle des « centres de formation professionnelle destinés à soutenir l’emploi et à combattre l’extrémisme religieux » : tortures, viols des hommes et des femmes, stérilisation de masse, absence de soins médicaux, apprentissage forcé du chinois et des chants révolutionnaires, punitions humiliations…
En mars 2020, l’Australian Strategic Policy Institute (ASPI) raconte comment, de 2017 à 2019, « plus de 80 000 Ouïghours ont été forcés de travailler dans des usines de 83 marques connues mondialement », nous dit le rapport de l’ONG australienne. Apple, Lacoste, H&M, Uniqlo, BMW, Huawei, et bien d’autres sont épinglés pour importation de biens produits en ayant recours au travail forcé ». Le gouvernement chinois admet « transférer des forces de travail du Xinjiang vers d’autres régions au nom de la lutte contre la pauvreté ». Le rapport parle de la destruction de milliers de sites culturels, de mosquées, de cimetières et de la construction de 380 nouveaux camps depuis 2019 qui viennent s’ajouter aux 1 400 construits les deux années précédentes.
« Xi Jinping ne vient-il pas de déclarer que sa politique contre les Ouïghours était juste et qu’il fallait aller jusqu’au bout ? Mais ça veut dire quoi aller jusqu’au bout », se demande une étudiante ouïghoure qui souhaite garder l’anonymat ? Le message est clair : les Ouïghours et ce qu’ils incarnent culturellement et politiquement ne sauraient être un frein à la réalisation de la grande Chine unifiée autour de la culture Han. N’en déplaise aux Occidentaux, la « question Ouïghoure » reste une affaire interne chinoise et Pékin n’acceptera aucune ingérence extérieure. D’ailleurs, les protestations émises en juillet 2020 par l’actuel ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, qui exige de Pékin d’autoriser la venue d’observateurs indépendants internationaux dans la province du Xinjiang, qualifiant de « pratiques inacceptables » l’internement massif des Ouïghours, n’a fait trembler personne.

« Rêve chinois »
1er octobre. J’ai rendez-vous avec Dilnur Reyhan, sociologue, enseignante à l’Inalco et présidente de l’Institut ouïghour d’Europe. Elle prépare une grosse opération médiatique avec le député européen Raphael Glucksmann. La publication d’une lettre ouverte adressée au président français Emmanuel Macron et la création d’un collectif de solidarité Ouïghour composé de 55 députés issus essentiellement des partis de gauche. Objectif : « dénoncer l’inaction des pays démocratiques qui ne cessent d’affirmer leur engagement dans la défense des Droits de l’Homme ». À l’ONU, en octobre 2020, 39 pays appelaient la Chine, dans une déclaration commune, à « respecter les droits humains ». À peine lue, cette « injonction » était court-circuitée par une autre déclaration. Celle de 55 pays, en tête desquels, la Chine, mais également le Pakistan, l’Irak, l’Égypte, le Soudan, ou encore le Yémen, l’Arabie Saoudite et la quasi-totalité des monarchies du Golfe. Et que dire de l’entrée le 13 octobre dernier de la Chine au Conseil des Droits de l’homme des Nations Unies ? Après « l’harmonie sociale » de Zhang Zemin, place au « rêve chinois » de Xi Jinping. C’est ce qui le pousse à imposer aux Ouïghours du Xinjiang « de vivre comme une famille heureuse ».
Le but ? Leur faire abandonner définitivement leur culture, leur identité et leur religion. Une politique intitulée « union des ethnies en une seule famille » qui débute en 2016 avec l’arrivée de plus de 100 000 cadres et fonctionnaires qui s’invitent dans les familles ouïghoures. En 2018, ils étaient un million. Leur mission ? Surveiller et mettre au pas. « Ils obligent les femmes à se dévoiler, à fumer, boire de l’alcool et manger du porc. Certains dorment dans le même lit que ces femmes ou dans ceux des très jeunes filles. On ne compte plus les viols, les agressions sexuelles qui ont poussé bon nombre de femmes au suicide. Le nombre de mariages forcés a considérablement augmenté. Ici comme partout où il y a oppression, le corps des femmes est utilisé comme « outil » d’humiliation collective. Tout refus de se plier aux désirs de ces fonctionnaires est prétexte pour vous envoyer dans un camp », raconte Dilnur Reyhan. Combien de femmes ont été arrêtées dans la rue et humiliées en public alors que des Hans leur coupaient les cheveux et leur robe jugés trop longs ? Combien d’hommes ont eu leur barbe rasée dans les mêmes circonstances ? La moindre opposition est perçue comme un acte terroriste. Ironie. Certains de ces fonctionnaires vont jusqu’à se plaindre sur les réseaux sociaux de ne pas être bien accueillis dans ces familles dans le cadre du programme imposé par Pékin de « vivre ensemble, cuisiner ensemble, manger ensemble, apprendre ensemble, dormir ensemble ». « Ils deviennent membres de votre famille mais vous obligent à vivre comme eux, à penser comme eux, à manger comme eux. C’est totalement tordu comme politique. On n’a jamais vu ça. Les gens s’autocensurent et renoncent même à toute pratique religieuse. Surveillés 24 heures sur 24, vous gommez, vous effacez vous-même votre culture. C’est ça l’instinct de survie », explique Mukaddas Mijit chercheuse en musicologie, danseuse et cinéaste ouïghoure de 38 ans. « Ce qui est hallucinant, c’est que la Chine est capable de mobiliser des volontaires pour mener cette politique. Il y a tout un discours qui consiste à leur dire qu’ils vont civiliser ces Ouïghours et que c’est positif pour l’avenir de la Chine. C’est du colonialisme », explique Thierry Kellner, professeur au département sciences politiques de l’université libre de Bruxelles où il enseigne la politique étrangère de la Chine.
Ethnocide
En diaspora, c’est la panique. Car enfermés au Xinjiang, parents et amis envoient tous le même message : « pour nous protéger, cessez vos activités antichinoises et vos protestations et surtout, ne nous appelez plus. Ça nous évitera la prison », résume Mukaddas. Pendant ce temps l’argent public coule à flot dans cette région, véritable pièce maîtresse des nouvelles routes de la soie, « Belt and Road », projet à 1 000 milliards de dollars. « C’est la porte de l’Asie centrale, l’accès au sous-continent indien et au Moyen-Orient, une région pivot riche, traversée par des infrastructures indispensables à ce projet pharaonique lancé par Xi Jinping. Il faut donc que la région soit la plus stable possible. C’est ainsi que la Chine justifie une répression qualifiée de préventive et d’essentielle. Toute représentation religieuse doit disparaître de l’espace public car la Chine est un pays communiste et athée », précise Thierry Kellner. Jouissant d’un contexte international favorable, avec l’émergence d’Al-Qaïda puis de l’État islamique, Pékin développe sa propre rhétorique anti-terroriste.
« Lutter contre le terrorisme certes mais aujourd’hui on parle de génocide culturel. Xi Jinping veut une Chine homogène et voir une minorité ethnique affirmer sa culture et sa différence, c’est problématique pour Pékin. D’où cette assimilation. Est-ce que ça va aller plus loin ? Quand on voit des Ouïghours enchainés et cagoulés monter dans des trains en partance pour des destinations inconnues, c’est inquiétant. On parle de crime contre l’humanité, d’ethnocide », poursuit Thierry Kellner. En s’emparant de tous les leviers du pouvoir, Xi Jinping a fait taire toutes les voix discordantes. Est-il désormais affaibli, isolé ? Est-il, au contraire, sûr de sa toute puissance, faisant ce qu’il veut quelles qu’en soient les conséquences ? « Xi Jinping n’est pas comme ses prédécesseurs. On ne sait pas si ce pouvoir est vacillant ou pas. On a vu des critiques émerger à l’occasion de la pandémie de Covid-19 de la part de certains intellectuels, mais aujourd’hui, soit ils sont en prison soit ils sont en exil », conclut Thierry Kellner. Si à Pékin le roi peut sembler nu, au Xinjiang, il montre à la face du monde que chaque génération n’est pas forcément un peuple nouveau, n’en déplaise hélas à Alexis de Tocqueville.