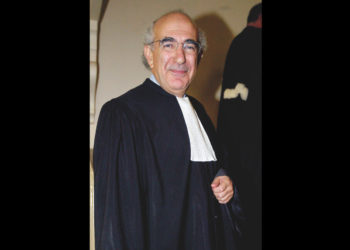Propos recueillis par Emmanuel Debono
Entretien paru dans Le DDV n°693 (été 2024)
Quelle est selon vous la spécificité de la crise actuelle ?
Une première réponse se trouve dans l’inversion des points de repère politiques et moraux de ce dernier siècle qui nous aidaient à distinguer la gauche de l’extrême droite. Les héritiers de Pétain défendent aujourd’hui les juifs et la gauche insoumise est devenue antisémite. Dans ma vie, déjà longue, je n’ai jamais assisté à un tel renversement des points de repère. Je souligne que le problème n’est pas du tout le fait que La France insoumise (LFI) soit propalestinienne, une position entièrement légitime, mais bel et bien qu’elle soit antisémite. On peut évidemment être propalestinien sans être antisémite. Dans les années 1970, Jean Amery, le grand essayiste autrichien, avait déjà compris que l’antisionisme de gauche serait la source la plus importante d’antisémitisme. Cet antisémitisme se dissimule derrière l’antisionisme. Il faut récuser à celui-ci sa légitimité. L’antisionisme est un antisémitisme qui se cache derrière le politique et la politique. Il est médié par les idéologies promues par les adeptes du Sud global – le Brésil, la Chine, l’Iran, la Russie – contre l’Occident.
Si la trame générale de l’antisionisme, depuis des décennies, a donné l’impression d’être constante, quelque chose a surgi ces derniers mois avec le 7-Octobre. Ce qui frappe, d’abord, c’est la globalisation synchronisée des événements. Une telle coordination n’existait pas par le passé. Elle tient à l’homogénéité croissante des élites universitaires et artistiques et à l’influence des organisations islamistes au sein des institutions occidentales, comme l’organisation Students for Justice in Palestine qui a essaimé aux États Unis et a ouvert des branches en France. Je dirais donc que l’inversion, l’homogénéisation et la synchronisation des discours sont inédites.
Est-ce vraiment nouveau ?
Oui et non. Quand l’équation entre antisionisme et racisme émerge dans les années 1970, elle est encore marginale et controversée. C’est toujours le cas en 2001, lorsqu’elle est proférée à la Conférence mondiale de Durban contre le racisme, organisée par l’Unesco. Mais aujourd’hui, cela semble véritablement devenu une partie de ce que le philosophe Antonio Gramsci nommait le « sens commun ». C’est devenu une doxa. C’est le résultat d’une propagande au long cours qui a été menée par l’ancienne URSS, les Frères musulmans et l’Iran, qui forment désormais un noyau unifié sur cette question.
« C’est la dérive du pouvoir, en Israël, vers l’extrême droite qui a donné largement prise aux critiques radicales en multipliant les provocations, en enfreignant le droit international (…). »
Il faut aussi compter avec vingt ans de travail de fond du mouvement Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) au sein des universités et dans le monde de l’art. Ce que nous vivons est une sorte d’aboutissement de cette campagne. J’ajouterais qu’un autre facteur est venu largement compliquer la donne, qui constitue une différence d’importance avec l’époque d’observation de Jean Améry : c’est la dérive du pouvoir, en Israël, vers l’extrême droite qui a donné largement prise aux critiques radicales en multipliant les provocations, en enfreignant le droit international, construisant des colonies illégales et rendant la vie des Palestiniens plus misérable. Tout cela se produit en même temps et contribue à une énorme confusion.
Comment les juifs sont-ils devenus des cibles aussi évidentes ?
Quand on regarde les années 1960, on observe une alliance entre les groupes d’immigrés, les noirs et les juifs. Les juifs sont actifs dans le mouvement des droits civiques des noirs. Les uns s’identifient aux autres, à tel point qu’il y a l’idée assez courante qu’il existe un continuum dans l’histoire de l’humanité entre l’esclavage et la Shoah. Pareil en France. Le Mouvement contre le racisme, l’antisémitisme et pour la paix (Mrap) s’adresse à ceux que visent l’antisémitisme et le racisme. Mais dans les deux cas, en France comme aux États-Unis, les juifs ne font désormais plus partie des minorités à défendre. Les juifs sont devenus des puissants, idée à la fois vraie (certains citoyens juifs peuvent détenir un pouvoir économique et financier) et résultat de projections fantasmatiques (tous les juifs seraient puissants).
Aux États-Unis, dans les années 1950 et 1960, les quotas qui existaient pour les juifs dans les universités commencent à disparaître. Les portes des établissements s’ouvrent et il s’ensuit une forte mobilité sociale : en s’affranchissant de la pauvreté, les juifs s’assimilent à la « blanchité », le marqueur le plus fort de la hiérarchie sociale. En parallèle, il devient aussi plus difficile d’être antisémite à cause de la Shoah. Les juifs jouissent, un temps, du statut de victime protégée. En France, c’est le même phénomène avec la mobilité sociale rapide des juifs alors que les ghettos de main d’œuvre immigrée se construisent. Une nouvelle fracture sociale se met en place entre ceux qui sont issus de l’immigration et les juifs.
Entre aussi en jeu une concurrence entre la mémoire de l’extermination des juifs d’Europe et celle de la colonisation, qui se sent mise de côté. Les Américains reconnaissent volontiers les atrocités de la Shoah dont ils ne sont pas responsables. Il n’en va pas de même avec l’esclavage qui fait partie, au contraire, de leur histoire. La Shoah tend à éclipser les autres horreurs de l’histoire de l’humanité, l’esclavage ou le colonialisme. Il y a un retour de bâton avec la montée, à partir des années 2000, de la grille de lecture du décolonialisme. L’antisémitisme n’y trouve pas sa place car l’histoire coloniale explique mieux l’exploitation économique, ce qui en exclut la Shoah.
D’autres influences ont-elles joué contre les juifs ?
Il y aurait tout un contexte géopolitique à évoquer, notamment après les années 1950, avec la propagation de l’antisémitisme soviétique, relayé par l’antisémitisme arabe, celui-ci ayant un caractère plus politique, marqué par son opposition au nationalisme israélien. Il se diffuse dans le bloc des pays socialistes et, au-delà, en Occident. Une figure comme Angela Davis, membre du Parti communiste, est par exemple une courroie de transmission de cette propagande qui amalgame la cause des noirs, la cause palestinienne et l’antisionisme de l’Union soviétique.
Il faudrait aussi mentionner le poids de l’Afrique du Sud, où, très tôt, les noirs voient dans Israël leur ennemi. Cette haine trouve sa source dans le fait que pendant l’apartheid, Israël vendait des armes à l’Afrique du Sud et se trouva en conséquence souvent associé au colonialisme. Quand les organisations israéliennes d’extrême gauche ont commencé à qualifier d’ « apartheid » ce qui se passait dans les territoires occupés par Israël, cela a scellé le processus. Ce n’est pas par hasard si c’est l’Afrique du Sud qui a saisi la Cour internationale de Justice en accusant Israël de « génocide ».
Sur quelles bases se rejoignent les islamistes et les militants décoloniaux ?
La gauche a remplacé le prolétariat avec la figure de l’immigré et par métonymie avec la « religion » de l’immigré. L’islamisme est vu par la gauche comme une réaction à l’impérialisme occidental. Tout ce qui n’est pas occidental est perçu sous le prisme de la colonisation. Il y a aussi une alliance objective. Les propagandes arabe et iranienne ont extrêmement bien su intégrer la propagande soviétique et de ce fait trouver les bons mots-clés qui vont au cœur de la galaxie mentale et morale de la gauche occidentale. Il suffit de faire travailler des mots comme « racisme », « réchauffement climatique », « colonialisme », « impérialisme »… pour stimuler ces alliances objectives.
« Il y a une tentative extrêmement intelligente et de grande envergure des islamistes d’utiliser les chaînes sémantiques de la gauche. L’identification de la gauche à l’islam n’aurait pas été possible si, au préalable, il n’y avait pas eu un mouvement inverse, des islamistes vers la gauche. »
Je n’aime pas trop l’expression « islamo-gauchiste » mais on est forcé de reconnaître qu’il y a une tentative extrêmement intelligente et de grande envergure des islamistes d’utiliser les chaînes sémantiques de la gauche. L’identification de la gauche à l’islam n’aurait pas été possible si, au préalable, il n’y avait pas eu un mouvement inverse, des islamistes vers la gauche. Oussama ben Laden n’a-t-il pas dit lui-même que si des alliances avec des impies – c’est-à-dire la gauche – permettaient la victoire, alors cela en valait la peine ? Les islamistes ont piraté de manière très intelligente la rhétorique de la gauche en faisant référence au racisme et à l’anti-impérialisme, alors que leur programme n’est autre qu’un programme de conquête.
L’anti-occidentalisme est quasiment devenu l’épine dorsale de la gauche internationale. C’est un espace idéologique qui est tellement vaste qu’il peut accueillir un grand nombre d’orientations et de fantasmes.
L’attitude de certaines présidences d’université face aux mobilisations antisionistes des étudiants ont pu surprendre. Comment analysez-vous ces réactions ?
Il y a eu, à la fin des années 1960, le rapport du juriste Harry Kalven, qui a fait date, et qui préconisait une doctrine de neutralité de l’université. Cette doctrine n’a pas toujours été observée, lorsque les universités américaines ont par exemple rendu de multiples hommages à George Floyd, après son assassinat par un policier, en 2020.
Aujourd’hui, avec un conflit complexe où s’affrontent les postures idéologiques, il n’est pas difficile de comprendre pourquoi beaucoup de présidents d’université ont eu du mal à s’exprimer. Mais je comprends aussi le sentiment des étudiants juifs sur les campus : on aurait dû réguler les expressions de haine. Dans un premier temps, l’administration s’est empêtrée dans le devoir de neutralité et son soutien à la sacro-sainte liberté d’expression. Cette indécision est devenue une faillite morale sans précédent quand les présidentes d’université auditionnées au Congrès n’ont pas pu exprimer une condamnation claire de tout appel au génocide des juifs. Il n’a pas été difficile pour l’extrême droite américaine d’instrumentaliser cette banqueroute.
C’est la première fois qu’une minorité est aussi violemment attaquée par d’autres et que l’Université ne la protège pas. La minorité juive s’est retrouvée en conflit avec les LGBTQ, les Afro-américains, les Latinos… L’université n’est pas équipée pour arbitrer entre différents groupes minoritaires mais pour les protéger. C’est cette fonction qui a été mise en déroute.
Ces mobilisations sur les campus ont souvent été comparées à celles de 1968 contre la guerre au Vietnam. Cette analogie vous semble-t-elle pertinente ?
Il y a d’énormes différences avec 1968. D’abord dans le rapport entre les universités et les étudiants. L’administration américaine et les enseignants sont devenus extrêmement sensibles à tous les discours sur la discrimination et, d’une manière plus générale, aux idées progressistes. Ce n’est plus le symbole d’une classe dominante. L’université n’incarne plus la classe dominante comme c’était le cas en 1968. Et il n’y a plus non plus de ségrégation raciale. En cinquante ans, il y a eu un renversement de valeurs assez spectaculaire.
Les étudiants me semblent être beaucoup plus confus. Ils ne font pas de différence entre les réactions à la mort de George Floyd et les positions propalestiniennes des manifestants qui ont applaudi les meurtres de masse du 7-Octobre.
1968 était festif. C’était l’utopie, la liberté sexuelle, la remise en question de toutes les conventions. Là c’est très différent. Les étudiants sont ceux qui instituent les normes ; il s’agit d’imposer un ordre normatif, pas de le transgresser. Ils réclament le désinvestissement, à savoir le retrait des accords de coopération intellectuelle, économique ou financière entre leurs universités et Israël. S’opposer à Israël est devenu équivalent au combat anticapitaliste et antiraciste d’antan.
N’est-on pas, également, face à une plus grande violence ?
Quelque chose a changé en effet dans la nature de l’affrontement. On réclame non plus seulement la fin de l’Occupation mais les territoires depuis 1948 – c’est-à-dire l’intégralité de l’État d’Israël – et pas seulement ceux annexés au terme de la guerre des Six Jours de juin 1967. En fait, pour les manifestants, il ne s’agit plus d’obtenir la paix mais d’anéantir Israël. Et l’affrontement devient presque physique car c’est une vraie guerre, avec l’idée de la disparition pure et simple d’un des deux partis. C’est la première fois qu’autant de gens réclament le démantèlement de l’État juif, le seul état au monde qui assure la sécurité de ces juifs.
Il y a là une singularité dans le débat qui assez difficile à saisir. Si l’on écrit sur Internet « right to existence », le moteur de recherche comprend que le seul endroit pour lequel on se pose la question, c’est Israël. C’est unique !
Cela ne ramène-t-il pas à une volonté de faire disparaître les juifs eux-mêmes ?
Oui bien sûr. On vous dira qu’il s’agit seulement des Israéliens et pas des juifs, mais il est évident qu’on ne parlerait pas avec une telle légèreté et une telle conviction morale de la disparition d’Israël s’ils n’étaient pas juifs. Rima Hassan a écrit « Israël est une monstruosité sans nom » et Aymeric Caron a déclaré que les soutiens d’Israël et lui-même n’appartiennent pas à la même espèce humaine. Cela n’est pas sans rappeler la déshumanisation des juifs par les nazis.
Pensez à quelque chose de plus subtil, par exemple le fait que le réalisateur britannique Jonathan Glazer – comme d’autres artistes ou intellectuels juifs — se doivent de se désolidariser d’Israël pour continuer à faire partie de leur groupe professionnel. C’est une démarche qu’aucun non juif ne fait, comme si ces artistes devaient donner des preuves qu’ils font partie de l’humanité en donnant des gages d’antisionisme.
Mais il faut aussi mentionner le fait qu’il y a une sorte de désensibilisation à l’accusation d’antisémitisme qui inquiète, comme une sorte de fatigue générale face à celle-ci. Il faut dire que Netanyahou en a tellement abusé lui-même. Ce n’est plus grave d’être accusé d’antisémitisme ! Cela, c’est très inquiétant.
Une partie de la gauche a-t-elle perdu sa boussole ?
Prenez un slogan terrifiant comme « Long Live Octobre 7th ». Il voudrait que nous nous réjouissions du massacre des juifs tous les jours, qu’il dure et dure encore, qu’il soit répété. Cette jouissance sadique je ne l’avais jamais entendue de la part de la gauche. Au Canada, Charlotte Kates, qui était la leader d’une manifestation d’extrême gauche et auteure de cette phrase, ne s’est pas désavouée. On a l’impression que quelque chose est déréglé. D’un côté, appeler des personnes avec un vagin des « femmes » provoque la furie des transgenres qui se sentent humiliés parce qu’eux non pas de vagin mais sont des femmes. Mais quand il y a des slogans éliminationnistes, qui célèbrent le massacre de civils, les enfants décapités, les familles qui brûlent, il n’y a aucune objection. Il est impossible de voir cela autrement que comme un dérèglement de la carte intellectuelle, politique et morale, notamment celle de la gauche.
« Je n’ai qu’une seule ligne rouge, c’est 1948. On ne peut pas discuter 1948. Ce qui délégitime et remet en question la décision de l’ONU de 1947 et la victoire militaire d’Israël de 1948, je ne l’accepte pas. »
Pendant la guerre froide les deux blocs essayaient de noyauter de l’intérieur la société adverse en créant des fausses nouvelles pour semer le chaos. Il y avait toujours un fil logique : le capitalisme allait détruire le monde ou le communisme allait détruire le monde. Mais là, ce qui est fascinant, c’est qu’il y a des discours et des intérêts complètement différents et qui se sont alliés. Un discours conservateur, religieux, nazi se greffe à un discours ultra-progressiste. C’est comme quand Lula et Chavez, deux symboles de la gauche, célèbrent l’Iran, qui est à l’avant-garde de l’obscurantisme, alors que l’Iran les célébrait en les appelant « les chefs de file du camp anti-impérialiste ». Des groupes anti-Occidentaux essaient de faire avancer leurs intérêts en véhiculant des contenus complètement opposés à la gauche traditionnelle (religion, justification du terrorisme, haine de l’Occident). Cette gauche est devenue une sorte de Frankenstein !
Comment réagissent les juifs selon vous ?
La grande nouveauté c’est que les juifs ne se sentent plus protégés par la social-démocratie, alors que cela faisait des décennies que celle-ci les protégeait. C’est l’effondrement d’un paradigme. Certains réagissent en évoluant vers l’extrême droite, d’autres en allant en Israël, mais il est troublant qu’une fois encore les juifs soient l’enjeu de changement de plaques tectoniques qui les dépassent.
Dans le contexte actuel, cette droitisation paraît inévitable, mais elle risque de se révéler une grande erreur historique. La droite ne protègera pas les juifs plus que la gauche. Pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les juifs sont à nouveau les seuls responsables de leur destin.
L’antisionisme et l’antisémitisme se confondent-il selon vous ?
La mode est de dire non, mais pour moi, oui, absolument. Je tiens à préciser : en ce qui me concerne, je n’ai qu’une seule ligne rouge, c’est 1948. On ne peut pas discuter 1948. Ce qui délégitime et remet en question la décision de l’ONU de 1947 et la victoire militaire d’Israël de 1948, je ne l’accepte pas. En revanche, discuter de savoir si avoir un « pays juif » pour les juifs, c’est être un pays raciste, pourquoi pas, c’est légitime. On peut discuter du droit des refugiés. On peut discuter des frontières et de l’évacuation des colonies.
Mais on ne peut pas remettre en question la légitimité de l’État d’Israël dans ses frontières d’avant 1967.

Eva Illouz, Le 8-octobre. Généalogie d’une haine vertueuse, Paris, Gallimard, 2024.