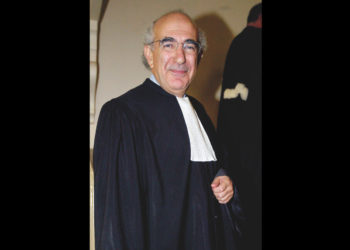Propos recueillis par Galina Elbaz, avocate au barreau de Paris, et Emmanuel Debono, rédacteur en chef du DDV
Article du dossier « Combattre la discrimination raciale » paru dans Le DDV n° 685, hiver 2021 (numéro offert à télécharger)
Comment concevez-vous votre rôle de Défenseure des droits ?
La défense des droits est un engagement que j’ai porté pendant des années dans le monde associatif, avec la certitude que la pauvreté n’est pas simplement un manque de moyens financiers mais aussi un non-accès aux droits. Il est essentiel de faire reconnaître ces difficultés d’accès et de rétablir les personnes dans leurs droits. Sans cela, on ruine la confiance en notre République, en notre démocratie, en notre société. C’est aussi comme cela que l’on pourra espérer une participation plus importante à la vie civique et aux élections.
Quelles sont les missions de votre institution ?
Elles consistent à rétablir les personnes dans leurs droits et à promouvoir ces droits, l’égalité, la lutte contre les discriminations. Nous avons cinq domaines de compétence : la protection des droits des enfants, la lutte contre les discriminations, la protection des lanceurs d’alerte, le respect de la déontologie des forces de sécurité et le respect des droits des usagers des services publics. Nous recevons autour de 100 000 réclamations par an. Plus des deux tiers concernent des difficultés rencontrées par des usagers des services publics. Sur ces 100 000, nous n’avons que 5 000 réclamations portant sur les discriminations.
Est-ce fidèle à la réalité ?
Cela ne dit pas du tout l’ampleur du phénomène. La plateforme antidiscriminations.fr que nous avons mise en place cette année [en février 2021] vise à mieux lutter contre les discriminations en faisant connaître tous les recours possibles, et en accompagnant les victimes, soit par nos juristes et nos délégués, soit par toutes les associations qui œuvrent chaque jour aussi avec ce même objectif. Avec cette plateforme, les personnes qui appellent ou qui utilisent le tchat peuvent échanger avec des équipes formées pour comprendre leur parcours, voir si cela rentre bien dans notre champ de compétence, et obtenir les premiers éléments juridiques. Fin novembre, nous en étions déjà à plus de 9 000 appels depuis la création de la plateforme en février 2021.
« Les blagues racistes ou sexistes font le lit des discriminations. »
Et elle a favorisé une augmentation importante du nombre de saisines de l’institution dans le domaine des discriminations. Cela montre l’intérêt d’une plateforme comme celle-ci : c’est une porte d’entrée avec, à la fois, un numéro de téléphone, le 3928, un site internet, auquel concourent associations et syndicats. Il y a plus de 1 200 points d’accès référencés en plus des permanences assurées par nos délégués territoriaux.
Quels critères discriminatoires prévalent-ils dans ces saisines ?
Sur les 5 000 réclamations reçues par le Défenseur en 2020, hors plateforme, le premier critère est celui du handicap. Et sur la plateforme, c’est l’origine. Cela prouve qu’il y avait des populations qu’on ne touchait pas et qu’on touche à présent, grâce à ce dispositif. Cela montre aussi la force des associations dans le monde du handicap, qui ont compris l’intérêt de nous saisir pour rétablir les personnes dans leurs droits. Cet accompagnement associatif, pour aider les victimes et saisir les tribunaux, est indispensable. C’est pourquoi je tenais à ce que le monde associatif soit étroitement associé à notre plateforme.
Le racisme est-il à l’origine des discriminations ?
Il y a clairement un continuum, c’est-à-dire que des discriminations surviennent souvent après des propos racistes ou sexistes. Il y a un terrain et un processus. Les blagues racistes ou sexistes font le lit des discriminations. Il y a aussi des cumuls, comme sexe et origine, sexe et handicap, origine et précarité, qui aggravent les situations.
« Ce n’est pas parce qu’une entreprise a signé une charte de la diversité qu’elle ne peut pas être discriminante. »
Cette plateforme se suffit-elle en soi ?
Non, évidemment. Au-delà du recours, deux autres piliers sont indispensables. D’abord la création d’un observatoire national, indispensable pour quantifier et faire reconnaître ces discriminations. J’ai rencontré l’ensemble des organismes de statistiques de l’État pour savoir ce dont ils disposent dans ce domaine, dresser un état des lieux et voir comment aller plus loin dans la connaissance du phénomène. Ensuite, développer les campagnes d’information, essentielles pour faire comprendre ce qu’est une discrimination, en quoi elle est délétère et destructrice pour les personnes, leur vie professionnelle, familiale, leur santé, leur état psychique… Tout cela est absolument indispensable pour aller plus loin : ce n’est pas parce qu’une entreprise a signé une charte de la diversité qu’elle ne peut pas être discriminante.
Comment le Défenseur des droits intervient-il quand il y a discrimination ?
Il y a d’abord la médiation, qui est l’un de nos principaux moyens d’action. Elle résout la majorité des problèmes qui concernent les usagers des services publics. Nous avons 550 délégués bénévoles sur le territoire qui tiennent des permanences. Une victime de discrimination qui nous contacte veut être rétablie dans ses droits, mais souhaite aussi que cela ne se reproduise plus. Nous avons des situations très concrètes avec des agences immobilières ou des entreprises refusant un dossier : un simple coup de fil permet dans de nombreux cas de résoudre le problème.
« Seulement 12 % des personnes se considérant victimes de discrimination dans l’emploi en raison de leur origine entament des démarches et ce quelles qu’elles soient. »
Nous avons aussi des pouvoirs d’enquête. Nous pouvons lancer une instruction et demander les pièces nécessaires. On entend les différentes parties, on fait des vérifications sur place, des testings également. Et nous pouvons faire des observations en justice quand elle est saisie. Nos observations sont alors suivies dans 70 % des cas. Les magistrats nous reconnaissent une expertise qui est essentielle pour faire avancer la jurisprudence.
Malheureusement, et vous n’en êtes pas responsable, les dossiers dont vous êtes saisie n’arrivent pas devant les juridictions…
Oui, sur le non-recours, les chiffres sont impressionnants. D’après notre baromètre réalisé avec l’OIT, seulement 12 % des personnes se considérant victimes de discrimination dans l’emploi en raison de leur origine entament des démarches et ce quelles qu’elles soient. Ce chiffre reste très faible malgré une augmentation chaque année. Les recours restent compliqués, longs. Il y a l’aménagement de la charge de la preuve, qui n’existe qu’au civil et qu’il faudrait élargir au pénal. Les montants des condamnations sont aussi tout à fait insuffisants. Ce n’est pas dissuasif. En résumé, l’entreprise, devant les prud’hommes, est juste condamnée à payer ce qu’elle aurait dû payer !
Aux États-Unis, les condamnations peuvent atteindre des millions d’euros en matière de racisme en entreprise. Il y a un fossé…
On peut et on doit aller plus loin en France sur les sanctions. Si les dommages et intérêts sont si faibles et consistent à payer, en termes de salaire, les sommes qui n’ont pas été versées, et non pas une lourde indemnité de préjudice, ce n’est motivant pour personne. C’est aussi cela qui crée du non-recours chez les victimes qui craignent de s’engager dans une procédure longue et éprouvante. Il y a aussi la crainte des représailles de l’employeur, même si le droit les protège.
« Nous souhaitons des sanctions plus importantes, dissuasives pour l’employeur, qui doit comprendre qu’il a intérêt à mettre en place un process pour que la parole qui alerte soit mieux entendue. »
Dans nos préconisations, nous souhaitons des sanctions plus importantes, dissuasives pour l’employeur, qui doit comprendre qu’il a intérêt à mettre en place un process pour que la parole qui alerte soit mieux entendue. Or, elle n’est souvent pas prise en compte, et les situations perdurent.

Cela passe-t-il par la formation ?
Notamment. La loi de 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté rend obligatoire la formation des recruteurs sur les questions de discriminations. Elle est essentielle mais il faudrait l’étendre à l’ensemble des personnels RH voire à l’ensemble des salariés. Former, c’est aussi prévenir ; c’est aussi, dès les premiers signes inquiétants, être en capacité d’agir.
Le Défenseur des droits a aussi la possibilité de désigner publiquement une entreprise fautive qui ne réagirait pas à ses recommandations C’est une option que je souhaite que nous utilisions davantage. Dans le monde de l’entreprise, la question de l’image compte.
Autre point important, ce n’est pas parce qu’il n’y a pas encore un procès ou une décision des tribunaux, que l’administration ou l’entreprise ne peut pas prendre de sanctions disciplinaires vis-à-vis des auteurs de discriminations. L’employeur n’est pas forcé d’attendre le judiciaire, bien au contraire !
En ce qui concerne l’accès aux services, on tombe dans le droit pénal pur et les statistiques sont alors effrayantes : il n’y quasiment aucune condamnation. Que peut-on faire pour sanctionner effectivement les comportements illicites ?
Il y a une vraie difficulté sur la question de la preuve au pénal, compte tenu du niveau d’exigence des juges pour caractériser l’intention discriminatoire, c’est pour cela que nous avons tendance à trouver que ça avance mieux au civil. Au pénal, il est indispensable que le parquet enquête rapidement parce que les preuves disparaissent. Ce point-là est capital car, quand il y a aussi peu de condamnations, on est dans une forme d’impunité.
« Depuis cinq ans, syndicats et associations peuvent participer aux actions de groupe mais il faudrait les ouvrir à des associations spécialement constituées, pas seulement celles qui ont cinq ans d’existence, comme le prévoit la loi. »
Les plaintes sont donc souvent classées sans suite… Comment faire ?
Il y a eu la création de pôles anti-discrimination dans les parquets en 2007 mais ils n’ont pas encore fait leurs preuves. Les statistiques montrent que ça ne bouge pas. Les magistrats dédiés ne sont pas désignés partout, ils ne sont pas formés spécifiquement sur ces questions. Or il y a un besoin d’expertise. Il faut aussi, concernant la police, avoir des fonctionnaires qui puissent intervenir très rapidement pour collecter les preuves.
Il est important que les associations insistent aussi car nous n’avons pas, nous, le pouvoir d’exercer des recours.
Qu’en est-il de l’action de groupe ?
Devant des victimes qui ne veulent pas forcément aller devant les tribunaux à titre individuel mais qui souhaitent faire cesser la discrimination, le recours collectif est important. Depuis cinq ans, syndicats et associations peuvent participer aux actions de groupe mais il faudrait les ouvrir à des associations qui se constitueraient sur ces causes-là, pas seulement celles qui ont cinq ans d’existence, comme le prévoit la loi. Un accompagnement financier serait aussi nécessaire car un certain nombre d’associations n’ont pas de moyens. On pourrait songer à un fonds de financement. Au-delà, la procédure de l’action de groupe devrait être clarifiée et aussi intégrer la réparation des préjudices.
Et sur la question des contrôles d’identité ?
Le Conseil d’État nous a demandé des observations sur l’action de groupe dont il a été récemment saisi sur les contrôles discriminatoires, ce qui témoigne, au passage, de la reconnaissance du rôle de notre institution. Le Défenseur des droits a déjà fait dans le passé des observations, qui ont contribué à faire reconnaître le caractère discriminatoire et donc illicite de contrôles par la cour d’appel de Paris en 2015, la Cour de cassation en 2016 et la cour d’appel de Paris cet automne au sujet du contrôle de trois lycéens à la gare du Nord… Une faute lourde de l’État a été reconnue dans ces cas, c’est une avancée.
« La traçabilité des contrôles d’identité est essentielle. »
Êtes-vous saisie par des personnes s’estimant victimes de tels contrôles ?
Seulement 5 % des appels sur notre plateforme concernent des contrôles d’identité discriminatoires. Les gens savent très bien qu’ils n’ont pas de preuve. Pourquoi un jeune nous appellerait-il quand il ne dispose pas de preuves ? C’est pourquoi je considère que la traçabilité est essentielle. Sans cela, rien n’avancera.
En Grande-Bretagne, il n’y a pas de contrôle d’identité parce qu’il n’y a pas de carte d’identité. Ce n’est pas que je sache une zone de non-droit. Ils ont des moyens de contrôle qui s’appellent des « stop and search », au nombre de 580 000 en 2020. La personne contrôlée, interrogée, ne se voit pas remettre un récépissé sur le champ mais elle peut, si elle le souhaite, l’obtenir au commissariat le lendemain. Cela signifie qu’il y a une trace.
En France, on ne sait pas s’il y a 5, 8 ou 12 millions de contrôles d’identité. On ne connaît pas non plus leur efficacité.
L’expérimentation du récépissé ou encore de l’enregistrement permettrait de sortir de cet inconnu. J’ignore quel serait le système le plus efficace. Ce que je sais, c’est qu’il n’est pas possible qu’il n’y ait pas de trace.
Comment avancer ?
Notre enquête de 2016 sur les relations police-population montrait que les jeunes hommes perçus comme noirs ou arabes avaient vingt fois plus de « chances » d’être contrôlés que les autres, un chiffre très impressionnant. Un certain nombre de policiers, de tous grades, sont conscients du fait qu’il y a là un problème. Or, la confiance dans notre démocratie passe par la reconnaissance de ce qui ne va pas. Les échanges réguliers avec nos homologues étrangers sont très fructueux, sans que leurs options soient forcément transposables en France.
Concernant les jeunes, êtes-vous souvent saisis sur la question des refus de stage ?
La jeunesse est une des priorités de mon mandat. Et la jeunesse nous saisit peu car elle connaît peu ses droits. Les démarches sont compliquées… La nouvelle édition de notre baromètre avec l’OIT, parue le 7 décembre, s’intéresse précisément à la perception des jeunes des discriminations dans l’emploi. Concernant les stages, nous ne sommes pas assez saisis. La prise de conscience dans les entreprises est essentielle. Il y a un moment où il faut poser la question : l’obligation de trouver un stage doit-elle peser uniquement sur le jeune ou aussi sur l’institut de formation, l’école, l’université ? On sait bien que les chances ne sont pas les mêmes au départ. On ne peut pas en rester au statu quo…
« Chaque année des personnes sont rétablies dans leurs droits, et il y a des avancées avec l’action de groupe, la reconnaissance de discriminations systémiques. On avance, c’est important de le dire ! »
Qu’en est-il des gens du voyage au sujet desquels vous avez récemment rendu un rapport ?
Il est très difficile pour eux de faire valoir leurs droits. Les saisines arrivent tard. L’État n’applique pas la loi qu’il s’est imposé sur le nombre d’aires pour accueillir ces personnes. Quant à la qualité de l’accueil… Mettre des sanctions et des procès-verbaux quand on sait qu’au départ l’État n’applique pas ce qu’il s’est imposé, cela me pose problème. La Délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement (Dihal) est en train de faire un récapitulatif des aires d’accueil. Mais il est clair qu’on ne peut plus faire des rapports sans associer les personnes concernées. L’expertise se trouve aussi sur le terrain, chez les personnes qui vivent les difficultés.
Le chemin de l’égalité paraît encore long…
On gagnerait tous à vivre dans une société non discriminante, plus inclusive. Ce n’est pas simplement par le bâton qu’on y arrivera. Une société plus apaisée, tout le monde en serait bénéficiaire. Notre institution agit concrètement même s’il y a des moments où c’est difficile. Mais, chaque année, des personnes sont rétablies dans leurs droits, et il y a des avancées avec l’action de groupe, la reconnaissance de discriminations systémiques. On avance, c’est important de le dire !